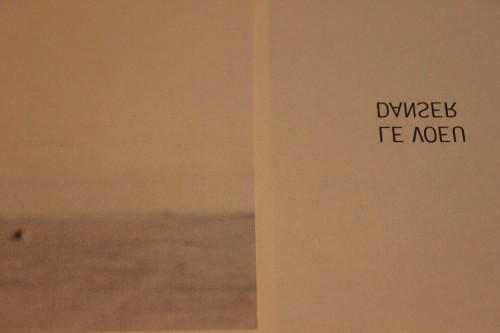28 septembre 2010
voeu pieu - livre à venir - a-v-e-n-i-r
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
l'enjeu
Périphérie de Tunis. Le terrain de football. Faute d’une pelouse élégamment tondue à ras, une surface jaune de terre battue à l’ancienne, où les cailloux volent sous les coups de pieds maladroits. Le ballon, lui, est très brillant (noir et argent) et porte le logo qu’il faut, là où il faut. Les gars qui arrivent troquent leurs jeans contre shorts et maillots aux couleurs de l’équipe nationale. La matinée avançant le terrain compte bientôt les vingt deux joueurs règlementaires, et chaque nouveau candidat à la balle se fend du même nombre d’accolades avant de se lancer dans des étirements…
Autour d’eux le beige initial des immeubles a pris un coup de vieux. Les façades sont ornées de la forêt habituelle des antennes satellites et des linges colorés. Quelques toits se terminent dans de grandes tiges de ferraille, promesse d’un étage supérieur ou d’une échelle pour les étoiles.
Des bancs fatigués font office de tribunes. Ceux qui, las du travail nocturne, préfèrent la farniente à la drible, s’y prélassent en grappe et ils sont nombreux… à parler fort… à s’improviser commentateurs sportifs… vantant les prouesses de celui-ci, ou raillant le pied crochu de celui là.
« Farid, ça te sert plus à rien de courir après la balle, tes jambes elles sont possédées par le shétan »
A les entendre on se dit que le match se joue peut être là. Dans la joute verbale des pseudos supporters. La coupe irait à celui qui fort de ses bons mots, aura fait rire plus haut ses acolytes.
A moins que le match ne se joue vraiment autre part. Sur les bancs d’en face, tout aussi fatigués, tout aussi tribunes mais féminines celles-ci… Où viennent de prendre place trois jeunes femmes au jogging nonchalamment posé sur les hanches. Les cheveux noirs tirés / tout droit sortis du brushing et retenus haut par une pince en plastique rose fluo. Elles font mine de ne pas prêter attention aux jongleries de ces messieurs, mais jettent quand même un œil, lorsqu’ils hurlent et ôtent le maillont pour un nouveau point marqué… rien de neuf sous le soleil en somme….
20:24 | Lien permanent | Commentaires (0)
24 septembre 2010
par pure tradition
C’était un vieux village. Un vieux vieux vieux village…. De tout temps on le survolait à bord des coucous, regardant sa terre sèche se craqueler de partout. C’était une terre habitée, au grand sens du terme. Une terre magique. Comme dans les jeux d’avant, tout habitant était doté d’une vie supplémentaire. Pour réessayer, mieux ou moins bien, en prévision des actes manqués.
Bref, un village aux règles souples et immuables, imaginé pour et par les hommes, avec l’injonction raisonnable de réinventer toujours.
Puis, vint l’heure incongrue et absurde de la séparation. Une ligne fut tracée dans la terre sèche, une ligne médiane, une tranchée pas bien profonde. De la-haut, à bord des coucous toujours, le village tout rond n’était plus que moitiés. Les maisons se répartissaient de chaque côté de la ligne et les anciens voisins se définissaient à présent toujours en fonction d’elle. Certains habitaient à droite et les autres habitaient à gauche. Les anciens voisins se trouvèrent des différences, des nouvelles habitudes. Bientôt même le climat changea au dessus des deux parties. Quand le soleil surplombait l’une, l’autre était arrosée par l’orage, et chacune des deux nouvelles populations se réjouissait de ce dont elle était dotée. Le temps passait et creusait artificiellement les différences.
Et puis vint un autre jour. En survolant le village, de nos coucous toujours, on vit les habitants sortir de chez eux, un par un, certains par grappes. Une mère, quelques enfants, une bande de jeunes gens, des hommes. Ils sortaient des maisons par les petites portes et se mettaient en marche. Semblable à des insectes d’abord éparpillés, puis en rang, ils prirent la même direction, celle de la frontière du milieu. Leurs pas résonnaient faisait trembler les murs. Plus ils se rapprochaient de la ligne plus ils étaient nombreux.
Ils formaient bientôt une sorte de file, qui soulignait leur ressemblance à tous. Ils n’entrèrent pas en collision. Au lieu de cela ils se mirent à marcher tous ensemble sur la ligne précisément, au milieu. Et les jours qui suivirent ils déplacèrent les maisons, les arbres, les murets, les chemins… au milieu.
Et les jours qui suivirent le milieu s’épaissit, s’épaissit encore, s’élargit tant et si bien qu’il reprit la forme du village, l’ancien village. le leur à tous.
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
16 septembre 2010
les deux font la paire
On mentirait en disant qu’on ne les avait pas remarqué. On ne voit qu’eux. La scène n’a plus d’âge. Lui 14 ans et elle presque treize. Ils sont assis sur un bloc de béton gris tacheté. Des baskets multicolores et rebondissantes leur pendent aux chevilles. Ils font semblant de parler d’autre chose. Se taquinent, se moquent des passants :
- t’as vu celui-là avec sa barbichette et ses lunettes façon laboratoire, ma parole on dirait l’père de Pinocchio !
Heureusement qu’il y a les passants... On se dit quoi déjà à la place des vrais mots ? Il lui raconte les derniers coups qu’il a fait avec sa petite bande d’apprentis voyous, y met les gestes et les gros mots. Elle fait semblant d’être impressionnée, balance de façon irrégulière ses deux pieds dans le vide, se gratte le cou, l’oreille, la joue, le sourcil, renifle. Elle ronge ses ongles mal peints et fais des petits dessins avec sa clef rouillée sur la croute de béton gris.
Tout à l’heure, il lui demandera à quoi elle pense, et elle répondra qu’elle pense à rien, pourquoi ?
Tout autour d’eux les immeubles attrapent ce qu’il reste de lumière en cet après midi d’automne. Quelques femmes se disputent les nouvelles du jour près des boîtes aux lettres un peu plus loin. Et quelques enfants font mine de ne pas s’ennuyer. Lorsque le silence les assomme tous les deux, il sortent un téléphone, un truc à tripoter, regardent ailleurs, regardent les arbres. Ici c’est la cité des Tilleuls, c’est joli comme nom pour un rendez-vous…
Oui mais c’est pas un rendez-vous.
Il sort de sa poche un petit walkman dont il semble très fier, gagne du temps en démêlant les fils des écouteurs. S’approche un peu d’elle pour lui glisser une oreillette.
Il, 14 ans, lui demande à elle , bientôt 13, à quoi elle pense.
et elle, bientôt treize, elle dit qu’elle pense à rien, pourquoi ?
13:39 | Lien permanent | Commentaires (10)
temporaire

Le jour était tombé depuis des lustres maintenant. Ils n’en avaient plus le souvenir. Ils marchaient près de la côte, leurs pas faisaient de temps à autre,glisser quelques cailloux dans le ravin. Ils devinaient ce qu’ils ne voyaient plus. La mer grise ou noire à une heure pareille, les rouleaux rugissant, dont il ne resterait demain que la trace de la marée. Et les rochers qui tombaient à pic et faisaient à la Manche de bien drôles d’oreille. La lune était là évidemment, lampadaire esseulé, trouant le ciel de sa gueule pâle. Ca leur faisait drôle de marcher ici. Comme si leurs pieds reconnaissaient….
Le paysage leur allait à la manière d’un vieux costume. Malgré l’étroitesse et la dangerosité du chemin, ils n’avaient pas à réfléchir pour mettre un pied devant l’autre, ils connaissaient ça. Combien de fois enfants, avaient-ils couru après un chien, un seau de crevettes savamment extraites des rochers dans chaque main ? Combien de fois avaient-ils manqué de se casser la figure, sous le regard terrifié d’un plus vieux, d’une plus vieille.
Ils arrivaient bientôt tout près des barrières. De chiches piquets de bois que l’on avait mis là pour empêcher la dune d’avancer.
Dos aux vagues, les deux épaules tournées vers les terres, ils aperçurent la caravane. Deuxième point de lumière, jaune cette fois, dans la nuit noire et fragile.
La caravane, ou quatre petites fenêtres découpées sur un terrain que l’on croyait désert au prime abord. Une éternité d’herbes sauvages….
La caravane où devait se préparer une soupe épaisse et chaude, faite de lentilles et de quelques viandes….
Ils s’approchaient encore et virent le terrain, cet immense champ en friche, se parer de mille et une loupiotes. Maisons temporaires sur roues. Maisons aux lumières jaunes et aux odeurs de soupe similaires. Leurs pas se fit plus secret. Leurs deux silhouettes de jeunes hommes définies par la lune. C’était chez eux, pour un temps. De nouveau et comme avant.
13:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
08 septembre 2010
hou !
On comptait sept tables nappées de carreaux vichy plastique. Sept tables qui séparaient les autres convives du type du fond. Il mangeait ce qu’on lui apportait à une allure minimaliste, mais mangeait tout. Des petites assiettes gondolées en inox s’empilaient devant lui, bâtissant sans le savoir une muraille de fortune. L’atmosphère était celle des diners très longs chez Solange, tout le monde se connaissait peu ou prou, de temps en temps fusaient quelques mots entre les tables, de tendres injure . Solange trimballait son gros cul et son tablier de clients en clients, offrant un sourire généreux à chacun et surtout des petits plats en sauces. La terrasse était recouverte d’une tonnelle épaisse, sorte de vigne sauvage, qui aurait en plein jour fait croire à la nuit.
Il était bientôt onze heures du soir, les âmes attablées bien imbibées d’alcools. Ils riaient plus ou mois fort, mais riaient globalement. Sauf lui. Il finit sa dernière assiette et la poussa du bout du coude près des autres. Il piocha dans une vieille sacoche un livre abîmé qu’il ouvra sans marque page. Dès lors il sembla disparaître. Ce qui jusqu’à maintenant dessinait à grands traits ses contours, sa silhouette, devint flou et on se savait plus si quelqu’un était assis là.
Une autre heure passa, une heure faite de soixante minutes irréelles, durant lesquelles le monde flotta, reproduisant la façon dont les mots du livre le faisaient tanguer.
Soudain une lumière traversa la tonnelle, une lumière venue de l’appartement du haut. Brusque. L’ombre de la vigne se posa instantanément sur le visage de l’homme, le tatouant de noir et de gris. Les feuilles donnaient des triangles, les branches des lignes mystérieuses. Et quelques détails végétaux, paraient son front de petits points inégaux.
Une vraie peinture aborigène, sans les couleurs. Sur sa peau de chef indien.
Véritable cartographie de leurs rêveries à tous. Le dessin de leurs songes.
12:58 | Lien permanent | Commentaires (0)
07 septembre 2010
grève d'en bas.
il n 'y a pas assez de fenêtres.
trop nombreuses les têtes. pour passer dedans.
qui cherche un courant d'air, qui voudrait respirer, avoir des droits encore dans quarante ans.
j'ai oublié toi
qui a couru beaucoup plus vite que les autres
beaucoup plus longtemps je veux dire
tu voudrais aussi respirer j'imagine ?
forcément.
ils ont oublié pour toi
peux pas leur dire, les connais pas
ils feraient semblant d'y réfléchir
c'est encore plus rageant
18:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
06 septembre 2010
eux mêmes.
Chaleur piquante de midi. Une rue suffit à traverser la ville. Une rue qui ne finit jamais, ni de tourner ni de monter. Tout est brulant :es poignées de porte, le capots des voitures, la peaux des filles assises en bas des marches, qui fument.
Tout est lourd à transporter. Les bouteilles de celui-ci, les provisions de celui-là… Les mouches se draguent au dessus des étales de fruits. Les gens sont autre part, à l’ombre, au frais dans les baraques. Tout est lent et les ventilateurs font danser les cheveux dans les petites épiceries.
Deux, trois voitures passent de temps en temps, troublant la tranquillité écrasante de la fin de matinée. Elles s’arrêtent pour les piétons.
Le passage clouté est très blanc et réfléchit la lumière comme un flash. Trois hommes pas misérables, ni appauvris, des hommes simples, traversent la rue. Le regard se fixe sur l’un d’entre eux en particulier. Sa veste lui élargit les épaules alors que son cou est si fin, son visage brun et émacié. Son costume et la coiffure, faute de traduire la richesse espérée, racontent comment la dignité se répartit également de chaque côté de la raie /finement tracée / sur les cheveux qu’il a mouillés un peu, tout à l’heure / devant la glace juste au dessus du lavabo / et qu’il voudrait voir tenir jusqu’à la fin du jour.
Dans la petite pochette à droite, pas de foulard bordeaux en soie, mais un peigne justement et un mouchoir en tissu.
Les voitures attendent patiemment, les vieillards ont bientôt traversé la rue, rejoint l’autre trottoir. Les deux autres parlent assez haut assez fort, et lui, notre homme, dans un même geste automatique, sort peigne et mouchoir de la pochette, redessine la raie dans les cheveux, éponge son nez et ses joues qui avaient transpiré.
puis jette un œil dans une vitrine qui faisait miroir… l’élégance même.
17:25 | Lien permanent | Commentaires (8)
05 septembre 2010
en échange.
Quatre et quatre sièges à l’écart du wagon. Ressembleraient presque à d’anciens compartiments.
Sur les appuis-têtes, leurs cheveux coupés ras laissent parfaitement voir la forme de leur crâne. Ils ont vingt ans, un tout petit peu plus. Ils vont rejoindre leurs régiments.
Y’a plus de guerre, ils disent, avec la bouche qui tirent vers le bas. De toutes façons y’a plus de guerre, alors nous on s’entraîne à autre chose.
Ils ont des chemises et des polos très repassés. Ils ont des plans de vies, pas une seule ride, des dents de fumeurs, des certitudes.
Ils n’ont que des certitudes. Des lignes droites. Y’a des types qui sont là pour leur donner des ordres, eux pour les exécuter et de toutes façons, ce sont des premières classes, les premières classes, sont bons qu’à prendre des coups de pieds au cul, paraît-il.
A voir leurs yeux pourtant, je me dis qu’il faudrait par grand choses pour que leurs lignes, se déraidissent, prennent des virages, se dé-résignent. A voir leur sourire quand ils parlent des ronfleurs de dortoirs, des marches de nuit sans objectif, des déserteurs et des maniaques,
je me dis qu’il y reste une bien grande dose d’enfance, et qu’on verra plus tard.
Ils disent ça aussi, on verra plus tard.
Ils allongent leurs pieds sur les tables très roses et propres du TGV de l’Ouest, à l’ancienne, et se refilent des tuyaux pour ne pas avoir froid quand ils partent en campement. Leurs épaules sont trop vite musclées et leurs visages rendus carrés par les cernes.
En les regardant descendre du train et agiter le bras pour dire au revoir, je me suis demandé, ces gars là, de Loudéac, du Mans, d’Orléans… ils font l’armée à la place de quoi ?
19:14 | Lien permanent | Commentaires (0)
01 septembre 2010
au temps où nous tournions
Sur la pellicule furent imprimés les corps secs et moulés de deux acrobates. Une vieille pellicule des années 70 qui crépite en passant dans le projecteur. Le bleu des corps ressort sur l’orange. Les traits sont un peu flous et pour la musique : les synthétiseurs ne referment plus les boucles d’arpèges qu’ils déclenchent. Cette image sort d’un film. Le film a duré une petite éternité durant laquelle s’étendait la fameuse idée. L’idée depuis le début c’est une femme. Chemisier un peu laineux, motifs fleuris, lunettes épaisses, que l’on voit vivre avec son enfant et son homme. Que l’on voit faire la cuisine, lire des histoires, ranger la maison. Nourrir tout le mone.
Une femme comparée a la figure du Sphinx, une femme peinte de hiéroglyphes, entre les murs du patriarcat.
Durant de longues séquences la voix off a fait la liste des choses qu’il faut oublier, celles qu’il s’agit d’apprendre, celles qu’il faut laisser de côté et celles qu’il faut au contraire déchiffrer au fond de soi. La caméra tournait et les personnages se déplaçaient à un rythme parfaitement calculé, de façon à ce que l’on ne les perde jamais de vue, et si cela devait arriver, de façon à ce que l’on se sente toujours concernés par eux.
Le film est maintenant presque terminé, cette image, ce sont deux corps d’acrobates en couleurs saturées, métaphore d’une souplesse presque divine et infiniment requise en ce qui concerne l’existence. Des corps capables d’accueillir et d’accompagner le mouvement tout autant que d’en être les initiateurs.
Rien ne dit au final s’il s’agit de deux acrobates, ou de l’image dédoublée et tout aussi psychédélique, du même corps féminin.
Un corps scindé,
parvenant à se plier en quatre,
mais pouvant aussi danser
de la façon la plus libre qu’il soit.
19:09 | Lien permanent | Commentaires (3)