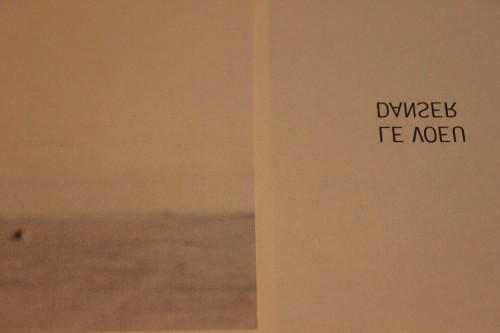29 septembre 2011
barbelés blues





Voyez la suite du western, visualisez ce qui arrive après. Visualisez le paysage vers le lequel Lucky luke se dirige, pareil à lui même, en lonesome cow boy. Visualisez ceci et agrandissez le champ.
C’est une plaine immense, caillouteuse, la chaleur fait naître à certains endroits, des hologrammes fumants, des mirages au goût d’essence.
En marchant vous ne pouvez faire autrement que déranger les cailloux, et ce roulis est votre musique. Vous aussi, vous traînez les pieds, ode à la vie lente et pesante qui se déploie dans le désert.
Devant vous, en guise d’horizon, une ligne de barbelés, agressive, piquante, étendue jusqu’à l’extrême. Et accrochée à elle, résistant aux vents, ou jouant avec eux, des sacs plastique de couleurs pâle. Limés par le sable. Des bouts de tissus, dont on ne peut oublier qu’ils appartenaient avant à un pantalon, à une chemise, à un manteau de femme.
Ils sont les vestiges téméraires d’une vie qui a lieu. De part et d’autre de la ligne. Avant même que les barbelés ne s’élèvent et séparent en deux camps, une terre dont on croyait que personne n’en voulait. Mais sous le ciel certains ont tiré des balles, et d’autres on foutu du poison goûte à goûte dans un vin qu’on vend cher.
Le désert est amaigri. Les barbelés ont le blues. Les haillons leurs tiennent pour peau de chagrin mais c’est tout ce qu’on peut faire… c’est pas une vie d’être fil de fer au milieu de rien…
12:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, texte, polaroid, france cutlure
11 septembre 2011
En somme, nous
Nous sommes rationnels, propres et organisés. Nous respectons les règles de conduite, sommes prudents en zone de travaux, et avalons de un à cinq fruits et légumes par jour. Nos chaussures sont pourvues de semelle anti dérapantes et nos sockettes de déodorant anti pieds. Nous apprenons les codes de la vie civile et évitons de saluer quelqu’un que l’on ne connaît pas. Nous fermons l’eau et le gaz quand nous partons en week-end, et trouvons raisonnables d’avoir trente ans pour faire 1 virgule huit enfants. Nous avons des trottoirs dans la majorité des villes, une journée d’appel à la défense et à la citoyenneté. Nous possédons de surcroit un système d’évacuation efficace pour les eaux sales, les gens sales, les sales gosses. Un puis vers 18 heures vient l’orage, le vent, et la grosse pluie ... Tout va à volo. Ca fait un bien fou.
16:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte
07 décembre 2010
mais pour où ?

Le couloir est très propre. Rien devant rien derrière. Rien sur les murs qui pourraient distraire…que du crépi beige tirant sur le saumon. Odile marche, met un pied devant l’autre avec une application déconcertante. Elle compte ses pas. « Et de trois, suivi de quatre, et de vingt sept et de vingt huit ». Lorsqu’elle touche la porte qui ferme le service, ne tente pas de la pousser ni de passer un œil dans la vitre brumeuse, fait simplement demi tour et recommence le compte. Elle présente sereine et souriante et entremêle maintenant ses chiffres de petites comptines dont elle semble aller chercher les mélodies au plus profond derrière le crâne, dans la piscine sans fond de la mémoire. Très très loin, il y a mille ans. Elle porte cette robe de chambre mohair qui commence à faire sa réputation, ses cheveux sont bien coiffés et sa peau est encore lumineuse malgré les nombreuses marques du temps. « Trente sept, trente huit » compte-t-elle, toujours sûre de ses deux pieds. Alors une jeune femme entre dans le couloir, son âge divisé en quatre. « Bonjour Odile ». Quelque chose se trouble dans le regard de la vieille femme. Elle s’approche. Passe une main sur le visage lisse de l’infirmière qui ne bouge pas. S’approche d’avantage, caresse de nouveau la joue, et le corps de la jeune femme s’est arrêté de bouger comme pour ne pas empêcher le retour fulgurant d’une mémoire qui n’a plus aucun ordre. Odile parle maintenant dans son menton, rien n’est audible sinon une liste de prénoms féminins qui ont remplacé les chiffres des pas. Alors que la lumière automatique du couloir vient de s’éteindre, elle pose sa tête et ses cheveux blancs comme la neige sur la poitrine rebondie de l’infirmière de garde.
Et puis tout sourire elle s’en va.
14:30 | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : photo, marie richeux, texte
30 octobre 2010
.
dormir-comm-une-marmotte-sous-morphine
10:35 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marie richeux, texte
correspondance
Paris 15 avril 1860, Ta Marie chérie.
Mon Eugène, je vole quelques minutes à l’aube pour t’écrire cette missive. Il fait étrangement froid pour avril et même la moindre chaleur de la lampe à pétrole me console. Je porte ta vieille veste de laine elle me fait de grand bras. J’aimerais qu’ils fussent suffisamment grands pour t’y bercer mon tendre. Cet océan d’oubli et d’hiver qui s’étend entre nous me noie depuis des mois et j’y ajoute les larmes. Je passe mes journées entières à la laverie. Madame Doutais est tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais nous avons du travail.
Mes nuits ne ressemblent à rien sinon l’inquiétude de te savoir là bas dans quelque chose de si grand que j’en oublie le nom.
Je suis ridicule mais je jalouse cette montagne que tu creuses de tes mains. Ridicule mais je jalouse le vent qui te fait les joues rouges. Je hais les hommes qui partagent ton quotidien et cette pauvreté d’ici qui te fit partir là-bas.
On dit qu’en Amérique, la gangrène guette les aventuriers je meurs de te savoir malade. Ecris moi.
On dit qu’en Amérique, les femmes guettent les aventuriers, je meurs de te savoir épris. Ecris moi, Eugène.
Il m’importe bien peu que tu reviennes riche, tant que la pierre ne t’a pas assommé, que la maladie ne t’as pas rongé le torse. Il m’importe bien peu ce que tu as ou non dans ton petit sac de cuir noir. C’est une idiotie que d’être parti si loin.
Je t’aime idiot, je grelotte et je t’aime. Rien n’est vrai que cela, écris moi.
10:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, texte
27 octobre 2010
free from larry. comme promis.
Ils ont seize ans. Cela fait vingt quatre heures qu’ils ne sont pas rentrés chez eux. Fumer des joints et faire du skate-board sur le bitume brûlant de Los Angeles n’attend pas une seconde et prend du temps. Affamés, assoiffés, ils gravissent quatre à quatre les escaliers de l’immeuble, le pantalon baggy leur tombe sur les fesses et ils manquent à chaque marche de se prendre les pieds dedans.
Ils écrasent sur le palier les cigarettes qu’ils gardaient collées au coin des lèvres. Leurs planches à roulettes dépassent de leurs sacs à dos. Ils ont l’air de tortue, ils ont l’air de campeurs, ils sentent la transpiration et mâchent un vieux chewing-gum.
Tom appuie sur la sonnette comme pour l’enfoncer dans le mur. Une femme vient ouvrir, elle aussi la clope au bec, l’air pas beaucoup vieille au final, et le corps d’un nourrisson posé sur ses hanches comme un petit animal.
C’est la mère de Tom. Qui fait demi tour, qui ne dit pas bonjour, qui flotte elle aussi dans un pantalon trop grand. Qui est fatiguée, et qui n’a pas les quelques dollars que Tom s’empresse de lui réclamer pour argent de poche.
Au bout du couloir, comme souvent, la cuisine, dans laquelle les deux grands dadets la suivent, se jetant furieux sur le frigidaire et descendant en une gorgée ce que nous aurions mis une semaine à boire. Tom disparaît aussitôt dans la petite chambre qui jouxte la cuisine, tandis que Clay, refermant discretos la porte du frigo, reste quelques secondes accoudé au mur. Le regard timidement puis très clairement posé sur la poitrine offerte de la mère de Tom, en train d’allaiter le tout petit dernier. Celui-là dort à moitié, mais le léger sourire inscrit sur ses lèvres porte à croire que les deux sont complices. L’un profitant du lait nourrissant de sa mère, l’autre de la vue hallucinogène d’un sein rond, lisse et gonflé.
09:58 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte
26 octobre 2010
grappes de raisins noirs.

C’est une histoire de brigands, dans le New-York des années quarante. Où les soirs fument, les gens fument, les rues fument. Aujourd’hui on enterre le boss. Sorte de patron d'une mafia quelconque, mort de vieillesse, après qui il va falloir tout réorganiser. Le pouvoir et l’amour.
Les types sont habillés de noir et portent des lunettes. Six d’entre eux soutiennent sur leurs épaules carrées le cercueil en bois brun et aux poignées dorées. Les femmes marchent plus loin, grappes de raisins noirs, plus belles les unes que les autres, les yeux fardés de sombre. Les dentelles se confondent au velours. Leurs cheveux sont remontés en chignon, rond dodu dans un filet cachés sous des capes de mousseline. Elles se regardent en coin. L’une fut l’amante, l’autre la mère, l’autre encore l’officielle, l’amour, la patronne. Le cimetière et les larmes expédiés, tous se retrouvent dans un vieux bistrot et tous se remettent à fumer et à boire. Ils négocient la suite.
Les femmes, petites grappes sombres, demeurent mutiques et mystérieuses, elles se sont installées au fond, dos au miroir, qui reflète leur masse opaque. Les hommes occupent les tables centrales qu’ils ont regroupées pour un banquet macabre. Le partage d’héritage est déjà sur le tapis.
Le patron derrière le bar, semble sur le qui-vive. Il sait que sous les costards ajustés dorment d’un demi sommeil, les revolvers chargés. Il sait que demain au plus tard les affaires reprendront et que sans chef, les affaires seront sanglantes. Il voudrait que son café n’en soit pas le quartier général. Alors que le vieux Juke box balance du Fitzgerald, les femmes se lèvent une par une, et défilent sous le porche. Elles sont une partie de l’héritage et le savent. La tête haute, elles savent aussi que rien ne se fera sans elles.
10:10 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, photo, texte
23 octobre 2010
on est sérieux quand on a dix sept ans

Ils ont bravé l’interdiction. Il est trois heures et quart du matin. Ils ont bravé toutes les interdictions en même temps, autant faire les choses vraiment. Ils sont assis sur le plan de travail de la cuisine collective. Ils y ont fait tenir une bougie de cire blanche qui dégouline. La flamme les éclaire par intermittence. Ils ont des visages d’enfants malgré les dix sept berges qu’ils défendent fièrement. Ils ont tous une clope au bec et s’apprêtent à engloutir le reste des desserts mal rangés. L’étage des filles, au troisième est séparé de celui des garçons, au quatrième. A partir d’une certaine heure il est interdit de descendre ou de monter. Mais c’est justement à partir de cette certaine heure qu’il est urgent, brûlant, de descendre et de monter. Dans les lits superposés là haut, ils ont joué la carte des oreillers qui donnent l’illusion des corps et il y a un puni, tiré au sort, qui est resté pour faire le guet. Hortense, Nico, Flore, Greg, Nadia, Philomène, Youssef, Jeremie, Noham. Ils sont sérieux. On est sérieux quand on a dix sept ans, non ? Ils ne le savent pas encore mais c’est leur dernière colonie de vacances. Dans trois jours lorsqu’ils seront sur le quai de la gare, que leurs parents les épieront de loin, ils pleureront toutes les larmes de leurs corps, parce qu’on est sérieux quand on a dix sept ans, non ? Pour l’instant Fred et Léa font l’inventaire des plus mauvaises blagues de la journée, Youssef regarde dans le vide à moins qu’il ne regarde Philomène. Noham cherche un tournevis pour démonter la hotte, pour voir. Nadia se souvient qu’elle n’a pas posté la carte postale pour son vieux père. C’est bête à dire mais ils sont super beaux. C’est fou comme ce genre d’images vous reste collé sur les parois du crâne. C’est fou comme elles vous paraissent appartenir à un autre monde, vingt cinq ans plus tard. Une rengaine dont on a perdu le refrain, une ritournelle sans rivage…
12:11 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : photo, marie richeux, texte
21 octobre 2010
suivant la pente hasardeuse des choses de la vie
Ils étaient quatre frères. Mars, Frédo, Hyppolite et Gustave. Chacun était né moins d’un an après l’autre, sauf le premier évidemment. En même temps avec un nom pareil il ne pouvait que venir d’ailleurs.
Mars nourrissait depuis toujours une passion pour tous les engins à moteur. A commencer par le rasoir électrique de son père, la tondeuse à gazon, plus tard les mobylettes évidemment et encore plus tard, ce qui est déterminant pour l’image qui suit, la caméra super 8 de son jeune frère Gustave.
Faute de n’avoir su apprendre à temps et par cœur les verbes du premier, du second et du troisième groupe,
Faute de n’avoir pas tout à fait adhéré à la version ultra libérale des cours de géographie de Madame Graffin,
Faute d’avoir trop souvent voulu initier une révolution silencieuse mais néanmoins révolutionnaire, Mars s’était fait viré du collège. Puis d’un autre collège, puis d’un dernier collège, et puis il avait eu seize ans et tout le monde avait été soulagé de pouvoir l’extraire su système scolaire.
Tout le monde, sauf sa pauvre mère. Quoique.
Mars n’avait alors plus quitté le garage de la maison familiale, et petit à petit tous les types du village - quelques demoiselles les jours de chance - lui apportaient leurs mobylettes et scooter en panne pour leur refaire une santé. Mars gagnait son pain.
Son cadet, le petit Gustave assistait après l’école aux séances de réparation. Il nourrissait lui une passion pour l’image qu’il captait sans fin à l’aide de la super 8 offert par l’oncle Sztern. L’oncle Sztern ayant des vues sur la mère, mais ça c’est une autre histoire.
La caméra tomba en panne un jour, Gustave demanda à Mars de la réparer ce que Mars fit en échange de… En échange d’une petite projection à destination des clients chauffeurs de bolides, un dimanche après midi par mois.
C’est ainsi que, petit à petit, et suivant la pente hasardeuse des choses de la vie, le garage familial et peu accueillant des quatre frères devint le cinéma du village, lieu d’ouverture et d’émerveillement pour le trois cent cinquante sept habitants de Thiévert.
Village qui évidemment, n’existe pas, ou alors à notre insu….
15:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
19 octobre 2010
la seconde surprise de l'amour

Personne n’a fait le coup de la panne à personne. Si l’ascenseur se trouve coincé entre le quatrième et le cinquième étage c’est une simple question de mécanique. Une histoire de câble mal enclenché mal fichu qui s’est pris dans la poulie. Il faut dire que l’appareil n’est pas tout neuf. Il n’y a qu’ à voir les lignes blanches qui strient la moquette des parois, on croirait les rides d’un arbre qui indiquent son âge lorsqu’on en scie le tronc. La moquette est d’origine. L’ascenseur aussi.
Au premier rebond, Kate avait senti son cœur opérer un brusque va et vient. De bas en haut suivant le mouvement de la cage d’ascenseur elle même, et là aussi selon une simple question de mécanique. L’émoi avait fait naître quelques taches de rousseurs sur sa peau à l’habitude si blanche /et Kate avait rattrapé de justesse un petit hoquet nerveux. Notez que ses cheveux étaient encore mouillés et gouttaient par mégarde sur le plancher de bois.
Léo, lui, avait simplement posé une main près des boutons d’étage, pour se retenir de tomber. La brutalité de l’arrêt lui ayant fait perdre l’équilibre. Cette main était venue, simple question de mécanique, frôler l’épaule de Kate. Légèrement mouillée elle aussi, vous savez pourquoi.
Le petit haut parleur, qui lui n’était pas d’origine, continuait de crachoter non pas une musique d’ascenseur, mais celle d’un orchestre triste et néanmoins vaillant, qui se serait mis à jouer sur le pont d’un bateau monumental prêt à sombrer dans l’eau. La mélodie épique fit songer à nos deux naufragés de la cage d’ascenseur qu’ils s’étaient peut être déjà rencontrés dans une vie antérieure. Une vie où Léo l’aurait pris par la taille sur la proue d’un bateau en lui disant qu’elle était une reine. Une vie antérieure beaucoup plus sirupeuse, vraiment antérieure. Bref, l’idée ne manqua pas de rajouter aux rougeurs sur les joues de Kate, dont les lèvres, simple question de mécanique, se trouvaient si près si près de celles de Léo, qu’on aurait juré à un futur baiser de cinéma.
05:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
14 octobre 2010
yeah yeah
Attention boule à facettes, et spotlights de toutes les couleurs ! Le plancher est lisse et brillant. Autour de la piste les chaises en bois sont disposées de façon extrêmement soignée. Quelques jeunes gens en costumes-cravates, tapent du pied, mâchent du chewing gum et fument des cigarettes en y mettant le ton.
Sur l’estrade, l’orchestre est au mieux de sa forme. Batteur, contrebassiste, chanteur belle gueule, tous endimanchés du même deux pièces noir et blanc / et chaussures vernies bicolores sur chaussettes repassées. Leurs cheveux sont tirés en arrière, gominés noir et brillants ce qui élargit passablement leurs fronts.
Rock n’roll ! Ils n’ont que ce mot là en bouche. Les do you love me baby, les déhanchés bien vus en cadence. Les swap bap, blue shoes. L’insouciance règne, les Etats Unis aussi. Il est l’heure d’être beau, il est l’heure de draguer sa voisine, l’heure de tester son nouveau passe-passe. Le contrebassiste est penché sur son instrument, comme Mike l’est sur Daisy, comme Teddy l’est sur Olfa, comme Mathias louche sur Jennifer.
Ces deux là, justement, aux vêtements accordés, se jettent sur la piste profitant d’un petit creux. Mathias, dans l’élan, fait tournoyer sa partenaire. Attrape ses hanches, ses minuscules poignets. La fait passer en dessous de ses bras fraichement remusclés. Son brushing est parfait, le haut de ses cheveux crêpés et noués par un tissu rose bonbon. Rose bonbon que reprend la robe, au décolleté discret mais affriolant. Le batteur se lance dans un solo mémorable, bientôt rejoint par le contrebassiste. Ils soutiennent et encouragent les deux danseurs à présent seuls en piste.
Un coup de cymbale et Jennifer est projetée dans les étoiles… le mouvement laisse entrevoir ses cuisses fermes et blanches. Elle manque un instant de percuter la boule à facettes, mais garde le sourire, ultra Bright à toute épreuve. Elle atterrit comme prévu dans les bras de Mathias qui ne manque pas d’en rajouter. C’est ici que le rythme se casse et la chanson bascule comme si de rien n’était en un slow langoureux. Le genre de choses qui surprend les filles en robe meringue, le genre de chose que savent très bien faire les gars de l'orchestre.Il faut dire que Mathias est très très copain avec les gars de l’orchestre…
15:59 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : photo, marie richeux, texte
08 octobre 2010
dialogue de murs

Errance dans les hauteurs d’Alger. Bab el Oued. Grand décor.
Une maison à droite, une maison après le virage à gauche, un mur, une éternité des murs blancs derrière lesquels se cachent … on ne sait pas. Rue en lacets, impression de montagne. La baie se détache derrière un port industriel que l’on avait oublié de regarder. Passé le dernier virage, soudain c’est beaucoup plus grand, soudain c’est au dessus de nous et tout autour, ça ressemble à quelque chose que l’on connaît tellement qu’il en est impossible à décrire. Le béton est sali et ajouré par endroit. Les fenêtres, voilà les fenêtres que l’on connaît par cœur : petites cases colorées, soulignées par des pare soleil, des rideaux rapiécés. La cour paraît immense, immense mais habitée. Une petite ville grouillante en échelle miniature… Là une table avec des fruits, là un mécano improvisé, ici quelques trafics illégaux et là encore trois femmes rondes entourées de voile. Les bagnoles dorment en bas, rangées en mauvaise file. Par cœur, on connaît ça par cœur. Quelque chose bat en nous différemment, comme si dans les yeux se superposaient la découverte et l’immense familiarité. La même sensation que la convocation d’un souvenir et pourtant, c’est la première fois que l’on voit cet endroit.
Au milieu des années 50, l’architecte Fernand Pouillon se voit confier la construction d’une cité en lieu et place d’un bidonville à Alger. Quelques années plus tard, il participe à la construction de plusieurs ensembles d’immeubles à Meudon la Forêt près de Paris. Ville de l’adolescence. Voilà on y est. mais ça on l’a su après, en rentrant. Comme quoi les yeux se chargent parfois de tirer sans nous les fils de nos histoires et de les emmêler à souhait.
Les deux bâtiments ont vieilli différemment et c’est un autre sujet. Mais de part et d’autre de la méditerranée, les murs résonnent.
09:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
06 octobre 2010
demandez la deuxième
Ce n’est pas encore l’aube. C’est l’heure bâtarde mais magnifique que je commence à connaître, entre la nuit noire et le timide début de quelque chose. Capitale. Nord est de Paris. Sur le terre-plein du boulevard, quelques femmes marchent, c’est ainsi qu’on les appelle, les marcheuses. Chinoises pour la plupart, elles portent une mince doudoune noire ajustée sur un jean. Pas d’extravagance, juste une permanente qui frise les cheveux habituellement lisses, et un brin de maquillage pour souligner les yeux et la bouche. A même le sol, des hommes étalent des morceaux de tissu dont on ne voit pas la couleur et peu importe d’ailleurs. Ils sortent de leurs sacs à dos une multitude de fils électriques, lesquels sont repliés sur eux même à l’image des enfants qui dorment encore à cette heure ci. Ils sortent aussi des postes radio d’un autre âge, une veste en laine, trois ceintures.
Celui-là a étalé devant lui une collection de chaussures uniques, en plutôt bon état dont on se demande vraiment au fond, si la seconde, celle qui ferait la paire attend dans le sac à dos… tant ce petit marché illégal et secret ne ressemble à aucun.
Si tôt déjà, d’autres hommes les éclairent avec une lampe torche que cherchent-ils ? Les lumières donnent à la scène une allure irréelle, oscillant vite entre le rêve étrange et le cauchemar. Même les immeubles font figure de drôles des monstres, des gardiens de la ville, des veilleurs de nuit. Ils surveillent ce paysage : des femmes marcheuses à la recherche d’hommes en mal de corps à serrer, et des hommes debout, les chiffonniers, devant leurs étals improvisé, les yeux sur leur mince marchandise.
Rien que de très normal pour une nuit bellevilloise. C’est sur ce territoire mutant, inapproprié, précaire et parfois dangereux qui la débrouille pour le dire gentiment, les amène à quatre heures du matin… Certains prient secrètement pour la lumière du jour.
09:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
05 octobre 2010
très très grande collection
05:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
01 octobre 2010
n'importe où finalement.
C’est une forêt ultramoderne, étirée par le haut du crane. Une multitude d’étages à deux chiffres… C’est une forêt qui a tout de la jungle imaginée il y a des années par les auteurs de science fiction les plus fous. Les flots humains sont parfaitement organisés et répondent pourtant à un immense chaos. La plupart des passants à cette heure porte un uniforme soit pour aller travailler soit pour aller à l’école. Il se dégage de leur marche une énergie folle que l’on peinerait à contrôler si elle était libérée, éparpillée, relâchée dans la nature / mais dans cette ville / elle ne déborde pas. Elle est contenue bouillante. Les pas qui tapent, bruit blanc sur le bitume, produisent à coup sûr de l’électricité, électricité, utilisée pour alimenter les panneaux publicitaires géants qui empêchent le ciel d’exister. De temps en temps des voix féminines sorties de nulle part, indiquent qu’il faut aller par là, ou par ici, ou encore descendre en prenant garde à la marche. Tout le monde danse en fait, une chorégraphie pareille à celle des militaires, on l’on attendrait que quelqu’un sorte du rang.
Au milieu de ce bal millimétré, au beau milieu d’un passage piéton zébré de blanc, un homme porte à l’épaule une caméra couleur aluminium. Son pantalon est un ensemble de poches, lesquelles poches sont remplies d’accessoires… Les passants le contournent, le bousculent parfois, mais semblent toujours l’éviter du regard.
Le regard pourtant, voilà ce qui le meut, voilà ce qui de temps en temps lui fait un pas sur la droite ou quelques pas devant. Il fend la foule sans ôter son œil de l’appareil, le deuxième œil est fermé, créant des rides sur son front juvénile. Comment avance-t-il alors, comment ne tombe-t-il pas ? Il est possédé par ce qu’il filme, induit dans le mouvement de cette ville et des milliers de silhouettes. Porté par sa petite musique intérieure, et un battement sourd et secret.
05:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
28 septembre 2010
voeu pieu - livre à venir - a-v-e-n-i-r
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
24 septembre 2010
par pure tradition
C’était un vieux village. Un vieux vieux vieux village…. De tout temps on le survolait à bord des coucous, regardant sa terre sèche se craqueler de partout. C’était une terre habitée, au grand sens du terme. Une terre magique. Comme dans les jeux d’avant, tout habitant était doté d’une vie supplémentaire. Pour réessayer, mieux ou moins bien, en prévision des actes manqués.
Bref, un village aux règles souples et immuables, imaginé pour et par les hommes, avec l’injonction raisonnable de réinventer toujours.
Puis, vint l’heure incongrue et absurde de la séparation. Une ligne fut tracée dans la terre sèche, une ligne médiane, une tranchée pas bien profonde. De la-haut, à bord des coucous toujours, le village tout rond n’était plus que moitiés. Les maisons se répartissaient de chaque côté de la ligne et les anciens voisins se définissaient à présent toujours en fonction d’elle. Certains habitaient à droite et les autres habitaient à gauche. Les anciens voisins se trouvèrent des différences, des nouvelles habitudes. Bientôt même le climat changea au dessus des deux parties. Quand le soleil surplombait l’une, l’autre était arrosée par l’orage, et chacune des deux nouvelles populations se réjouissait de ce dont elle était dotée. Le temps passait et creusait artificiellement les différences.
Et puis vint un autre jour. En survolant le village, de nos coucous toujours, on vit les habitants sortir de chez eux, un par un, certains par grappes. Une mère, quelques enfants, une bande de jeunes gens, des hommes. Ils sortaient des maisons par les petites portes et se mettaient en marche. Semblable à des insectes d’abord éparpillés, puis en rang, ils prirent la même direction, celle de la frontière du milieu. Leurs pas résonnaient faisait trembler les murs. Plus ils se rapprochaient de la ligne plus ils étaient nombreux.
Ils formaient bientôt une sorte de file, qui soulignait leur ressemblance à tous. Ils n’entrèrent pas en collision. Au lieu de cela ils se mirent à marcher tous ensemble sur la ligne précisément, au milieu. Et les jours qui suivirent ils déplacèrent les maisons, les arbres, les murets, les chemins… au milieu.
Et les jours qui suivirent le milieu s’épaissit, s’épaissit encore, s’élargit tant et si bien qu’il reprit la forme du village, l’ancien village. le leur à tous.
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
16 septembre 2010
temporaire

Le jour était tombé depuis des lustres maintenant. Ils n’en avaient plus le souvenir. Ils marchaient près de la côte, leurs pas faisaient de temps à autre,glisser quelques cailloux dans le ravin. Ils devinaient ce qu’ils ne voyaient plus. La mer grise ou noire à une heure pareille, les rouleaux rugissant, dont il ne resterait demain que la trace de la marée. Et les rochers qui tombaient à pic et faisaient à la Manche de bien drôles d’oreille. La lune était là évidemment, lampadaire esseulé, trouant le ciel de sa gueule pâle. Ca leur faisait drôle de marcher ici. Comme si leurs pieds reconnaissaient….
Le paysage leur allait à la manière d’un vieux costume. Malgré l’étroitesse et la dangerosité du chemin, ils n’avaient pas à réfléchir pour mettre un pied devant l’autre, ils connaissaient ça. Combien de fois enfants, avaient-ils couru après un chien, un seau de crevettes savamment extraites des rochers dans chaque main ? Combien de fois avaient-ils manqué de se casser la figure, sous le regard terrifié d’un plus vieux, d’une plus vieille.
Ils arrivaient bientôt tout près des barrières. De chiches piquets de bois que l’on avait mis là pour empêcher la dune d’avancer.
Dos aux vagues, les deux épaules tournées vers les terres, ils aperçurent la caravane. Deuxième point de lumière, jaune cette fois, dans la nuit noire et fragile.
La caravane, ou quatre petites fenêtres découpées sur un terrain que l’on croyait désert au prime abord. Une éternité d’herbes sauvages….
La caravane où devait se préparer une soupe épaisse et chaude, faite de lentilles et de quelques viandes….
Ils s’approchaient encore et virent le terrain, cet immense champ en friche, se parer de mille et une loupiotes. Maisons temporaires sur roues. Maisons aux lumières jaunes et aux odeurs de soupe similaires. Leurs pas se fit plus secret. Leurs deux silhouettes de jeunes hommes définies par la lune. C’était chez eux, pour un temps. De nouveau et comme avant.
13:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte