18 décembre 2011
quand c'est la nuit, personne ne se risquerait à marcher dessus

Ils voleront. Là où ils seront tout à l’heure ils voleront avec des ailes. Distraits par la lune. Emmenés par d’étranges ficelles.
Dans ce sommeil d’enfants où il y a toujours un peu de fièvre déposée sur l’oreiller, les chiens se seront réveillés. Les chiens et la forêt.
La vieille dans la chambre d’à côté qui tout le jour prépara la soupe et coupa du bois pour le poêle, marmonne des contes revenus de Russie. Mais elle s’endormira plus tard, étourdie de ses propres histoires. Shéhérazade des balkans.
Pour l’heure, le vent souffle. Le vent souffle, et ce n’est pas du sable qu’il dépose sur les paupières, mais de l’écorce, du lichen, de la mousse, de la peau des arbres sur la peau des paupières, pour que les rêves soient faits de sève….
Le jour les bouches sont bavardes et débordent de boue. La nuit, elles ne parlent pas et les rêves ne sont pas encore brûlés, ni enfouis dans des malles.
Le jour, quand le vent est là, on refuse d’y croire, la nuit c’est jamais pareil quand il souffle, et c’est qu’il faut, au moins, pour que les enfants dorment, que les chiens se réveillent.Le strict minimum. Le jour, quand les autres sont là, on refuse d’y croire, quand c’est la nuit, personne ne se risquerait à marcher dessus.
13:15 | Lien permanent | Commentaires (10)
03 décembre 2011
sinon
si bien que d'autoroute nous ne primes que les bretelles, et encore sans les bras, l'hotel n'avait que des murs blancs, nous n'avions rien prévu pour palier à ce ciel, on a fait bon chic bon genre, comme ça, rendre la monnaie et avaler des biscuits secs. on a traversé la rue pavée, marché en cours, bourse au tricot, j'avais rien vu de pareil depuis mon seul passage en Alsace, j'ai pensé dieu comme la chapelle de Ronchand me paraît loin aujourd'hui, dieu comme il faudrait savoir faire du vitrail, et j'ai avalé ma purée comme les autres, comme les autres, les escalators. un jour, une fois, dans l'escalier, on a croisé les jumeaux par pair, très acides, ils ont flanché, pas nous, car on a de qui tenir,
sinon notre film est montré là dans l'intégralité, grâce à Jeanjaune, et au site Portable. de cette manière il retraverse l'atlantique http://portable.tv/film/post/portables-guide-to-french-indie-film/9/
une aubaine.
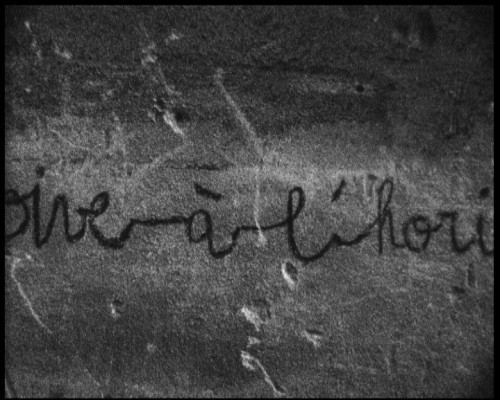
10:01 | Lien permanent | Commentaires (9)
jure
calo back
tule noir pas épais,
dans le tapis mécanique
nous passe devant sans nous voir
excema dans l'oreille
tu dirais pas qu'elle est belle
mais elle est
09:52 | Lien permanent | Commentaires (5)
02 décembre 2011
il y a d'autre tour
Certaines montagnes sont angulaires et tout ce que vous ferez pour les lisser d’un bras, ne sera qu’échec et fatigue. Certaines montagnes sont faites, c’est l’histoire, pour couper les poignets, blesser les genoux, faire fumer les poumons, plier les chevilles. Certaines montagnes n’accepteront jamais que vous parveniez en haut. C’est une vielle fierté de la roche, c’est con comme un homme, mais c’ est ainsi.
Cette montagne là, s’est laissée, patiner, amadouer, foutre en l’air par le vent et les sources. Elle est ronde c’est un ventre tendu. Vous y allez comme pas deux, fragile cordée d’estime, vous passez par là où personne n’est plus venu. Vous chatouillez l’idée d’être plus fort qu’un autre. Vous vous donnez du mal et suez de votre eau.
Une fois là haut, vous surplombez une moquette d’arbres, de mousses, de liquens, vous avez la gerbe et fin, et votre tête cogne du vin cuvé d’hier. Des gris verts, pâles, bruns et jaunes. Des écorces de bouleaux à s’en faire tourner le crâne. Vous asseyez pour souffler et la roche ronde est trompeuse.
Juste derrière vous, c’est la tour de la vierge, petit hôtel aussi rocheux que le reste, des fleurs squelettes des cierges à bout de course. Elle penche, la garce, comme à Pise. Toutes les pierres qui la composent vous apparaissent indépendantes. Elle penche. Et vous approchez de la falaise pour pisser dans le vent, vous penchez aussi, jusqu’à l’éblouissement.
11:06 | Lien permanent | Commentaires (2)
vous pouvez souffler
Quand il fait jour c’est jaune et brun. Quand il fait nuit c’est de la nuit. Découpée en feuilles. Découpée en arbres. Découpée en silence. C’est à peine plus lourd que du vent.
On est assis dehors, une clope dans chaque bec, de la soupe dans chaque bol, de la fumée au dessus des genoux. On cherche à savoir si le ciel au delà de nos têtes est plus clair qu’ailleurs. Si les étoiles y sont plus précises.
Chaque soir, mais on ne nous l’a dit qu’après, chaque soir, un renard, entre, je ne sais par où, vient manger dans la gamelle du chat, à moins que ce ne soit devenu la sienne.
Il y a quelques années, c’était un renardeau, on ne pouvait pas l’approcher, tremblant, pas bien grand, si roux, si beau toujours. Des espagnols qui vivaient un peu là, l’avaient appelé Zorro, parce qu’en espagnol, renardeau c’est Zorro, c’est tout. Depuis c’est Zorro. Les jours où la chasse est ouverte, que les coups de feu pleuvent en forêt, les jours où le renard peut se faire canarder parce qu’il aime autant les faisans que l’amicale des tireurs. Ces jours là, ces soirs là, ils attendent inquiets son retour à la gamelle. Assis parfois, pareil que nous, sur le rebord de la maison, qu’il fende les buissons quelque part et vienne attraper un morceau de viande fraîche.
Et rentrés, se ramasser en bande autour de la cheminée, rassurés, jouant du mikado géant. Zorro est revenu.
10:57 | Lien permanent | Commentaires (0)
18 novembre 2011
et les textes non parus paraîtront - le quatre décembre
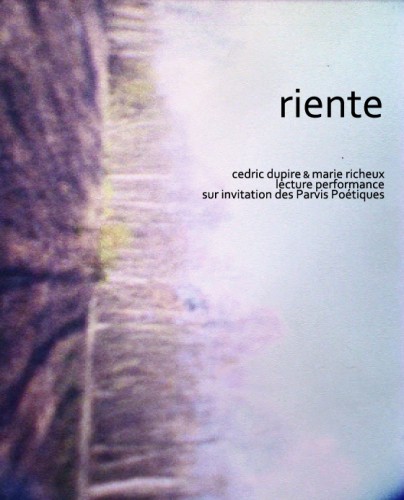
12:10 | Lien permanent | Commentaires (1)
08 novembre 2011
tous saints

On fait tout à l’envers de travailler ce jour là. On marche entre les tombes. D’abord si grandes, si lisses, portant haut la croix et le marbre,
et puis plus cascassées, plus discrètes aussi, parfois recouvertes par la terre et les pas.
On fait tout à l’envers de travailler ce jour là.
Le gardien même, tout de bleu vêtu, va retrouver un coin d’ombre, près des vivants pas loin des morts, pour finir la journée et retrouver le calme. Le gardien rentre chez lui.
Ici et là, des petits gobelets de rhum sont déposés sur les stèles. Un christ en ferraille côtoie un collier de fleurs. On a coupé la tête d’une coco, bien verte, et bien grosse et glissé une paille dedans si d’aventure les âmes longtemps avaient une petite soif.
Crois moi ou pas c’est l’océan qui lèche les tombes, et le peu de vent nous sert de respiration. Il n’y a pas de chemisiers noirs. Il n’y a pas de chagrins ridés. C’est une visite amicale et émue, au souvenir de qui n’est pas tout à fait enfui. C’est une célébration des coquins qui réclament attention. C’est une après midi chaude, aux ancêtres, à Saint Denis de la Réunion
11:34 | Lien permanent | Commentaires (0)
le petit meneur nu
Le torse d’un tout jeune homme, onze ans, ne contient que les poumons. Rien d’autre encore que ces organes mous et traversés de tant de routes. Pas de muscles saillants, pas de poils au milieu, pas de carré-rectangle au niveau des épaules. Pas de pomme d’adam pour trahir la gorge. Les tout jeunes hommes ont un relâchement dans le pas, qu’ils perdront bien trop vite. De la même façon qu’ils finiront par perdre le vif éclat de leurs yeux.
Il ne tient pas de longe, il n’a rien accroché à la gueule de son animal, mais c’est son animal. Il a posé délicatement sa main sur le poitrail, là où il fait chaud dormir pour les mouches et les tants. Le cheval est gris et la terre est battue d’ocre rouge. Ils ont tous les deux des yeux fait au charbon et le regard qui doucement se déporte sur la gauche.
C’est le meneur, le petit meneur nu, dont le sexe ressemble à celui d’un nourrisson, mais qui a la main déjà sur la hanche et une façon de poser le pied sur le sol qui rappelle la foulée. Au dessus du genou, les cuisses se dessinent et trahissent les courses folles qui les épuisent avant le sommeil.
Ils sont seuls au milieu d’un monde qui ne les accueille pas, mais ne traque pas leurs souvenirs. Ils sont un centaure, rendu à ses pôles. Une peinture d’étonnement.
11:31 | Lien permanent | Commentaires (0)
29 septembre 2011
.......................... (c) ROMAIN BERNINI ::: LOnely Riot

Avant c’était un mur contre lequel on jouait à la balle. Un mur dur, peint en bleu contre lequel nous envoyions cogner toutes sorte d’objets ronds. Avant ici, on riait. Avant nous étions enfants, et la guerre n’était pas la même. Si tu regardes dans le coin, tu te souviendras que nous construisions de nos mains de petits châteaux de sable, sur lequel personne n’aurait osé soufflé, et ces batards ont marché dessus en gros godillots.
Il est fou de rage. Son bras s’abat, ses muscles lourds se laissent choir comme du plomb, il lance, et nous n’avons pas vu ce qu’il lance, il est dans la fumée rose, il veut faire croire que sa colère est muette.
Mais on le connaît. Ses joues rondes, qui pointent au dessous de la barbe, la chemise entrée dans le pantalon pour ravir sa mère. Son bandeau de tissu pour tenir les cheveux qu’il a laissé pousser. On le connaît, on sait comme il boue.
Sa rage c’est la notre et si elle est rose c’est qu’elle est pourrie et radioactive. On vous aurait fait imprimer un carton d’invitation pour notre belle émeute du cœur, vous ne seriez pas venus, alors on a commencé la fête sans vous.
On a fait pété les fusées solaires, on a fait déborder la piscine et on a même brûlé les livres en pleurant.
Avant c’était un mur contre lequel on jouait à la balle. Un mur dur, peint en bleu contre lequel nous envoyions cogner toutes sorte d’objets ronds, en dansant. Aujourd’hui il n’y a que la fumée pour danser. Le mur est monté trop haut.
12:57 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peinture romain bernini, texte marie richeux
barbelés blues





Voyez la suite du western, visualisez ce qui arrive après. Visualisez le paysage vers le lequel Lucky luke se dirige, pareil à lui même, en lonesome cow boy. Visualisez ceci et agrandissez le champ.
C’est une plaine immense, caillouteuse, la chaleur fait naître à certains endroits, des hologrammes fumants, des mirages au goût d’essence.
En marchant vous ne pouvez faire autrement que déranger les cailloux, et ce roulis est votre musique. Vous aussi, vous traînez les pieds, ode à la vie lente et pesante qui se déploie dans le désert.
Devant vous, en guise d’horizon, une ligne de barbelés, agressive, piquante, étendue jusqu’à l’extrême. Et accrochée à elle, résistant aux vents, ou jouant avec eux, des sacs plastique de couleurs pâle. Limés par le sable. Des bouts de tissus, dont on ne peut oublier qu’ils appartenaient avant à un pantalon, à une chemise, à un manteau de femme.
Ils sont les vestiges téméraires d’une vie qui a lieu. De part et d’autre de la ligne. Avant même que les barbelés ne s’élèvent et séparent en deux camps, une terre dont on croyait que personne n’en voulait. Mais sous le ciel certains ont tiré des balles, et d’autres on foutu du poison goûte à goûte dans un vin qu’on vend cher.
Le désert est amaigri. Les barbelés ont le blues. Les haillons leurs tiennent pour peau de chagrin mais c’est tout ce qu’on peut faire… c’est pas une vie d’être fil de fer au milieu de rien…
12:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie richeux, texte, polaroid, france cutlure
24 septembre 2011
le notre
Notre stop
Notre chant des vélos
Notre tour du lac
Notre nuit
Notre chien Bomber
Notre matin plagié
Notre larme le 1er janvier
Notre bateau araignée d’eau
Notre larme le 23 août
Notre purée de pommes
Notre marche la nuit
Notre maison des Ebhiens
Notre pont
Notre ancien hôtel
Notre errance d’aéroport
Notre danse des ombres plates
Notre ping-pong instable
Notre papier
Notre film
Notre nuit d’amour ratée
Notre nuit
Notre piscine sur le toit
Notre tunnel notre pluie
Notre liberté diamant
Notre absence
Notre idée du ciel
Notre mariage(s)
Notre couleuvre
Notre télévision parallèle
Notre piscine au sous sol
Notre blessure
Notre thé partisan
Notre écran noir
Notre silence étouffé
Notre virus étouffé
Notre baignoire
Notre édition
Notre temps
19:44 | Lien permanent | Commentaires (6)
qui finance l'impression des flyers ?
19:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
si d'air - bout 2
Je mets un pied le long du poteau,
je mets l’autre plus haut sur le même poteau,
les mains grattent la ferraille, la ferraille gratte la peau,
Tu me ronges ou quoi?
J’augmente les pieds plus haut plus haut.
Je dis : une fois sur le fil, le vieux fil du vieux fou, je trouverai l’air qu’il y a laissé.
C’est l’injustice que personne ne le respire plus, le gâchis dégueulasse.
Moi je m’y colle je dis, au cas où que de l’air serait resté en stock,
pas respiré par l’acrobate,
mais qu’il avait en projet de,
un air qu’il aurait mis dans ses poumons si il y avait été encore,
moi je m’y colle,
j’y monte,
qu’en mes poumons y’aurait forcément une place, que dis-je ?
de jolis tuyaux.
19:30 | Lien permanent | Commentaires (1)
no reply dit-il
Après la clairière, il y avait ces deux trois lattes de bois qui faisaient une maison,
et dans cette maison une chaise, et pour cet homme un coin chaud.
Il était assis, n’avait en rien touché à la lumière et, la pièce s’éclairait par intermittence.
Son visage, ses joues, la naissance de sa barbe, n’avaient pour ampoule, qu’un bout d’astre. Avec la main il caressait le mur plein d’échardes, avec la main encore, il cherchait des yeux pour voir. Personne n’a vu mes yeux, par hasard ?
Dans le silence sa voix lui revint, à peine augmentée de l’écho, un drôle de râle.
Alors il chercha ses mains, quelque chose comme ses mains, pour toucher de nouveau… Mais rien ne vint ni les mains, ni la réponse.
Au dessus du bois quelques étoiles lui faisaient une couronne. Quelques oiseaux de nuit ne se reposaient pas. Quelques bruissements de feuilles chuchotaient que le monde est vivant. Il osa, en criant, personne ne m’a vu, c’est ça ?
Je me cherche moi.
La voix se cogna à peine aux parois de la pièce et l’enveloppa comme une couverture froide. C’était du silence autour, de ce silence brunâtre si difficile à peindre…
19:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piers faccini, no replys, nouvel album, texte marie richeux, france culture, polaroid
j'ai perdu ma tribu tous mes frères et mes soeurs que sont-ils devenus
19:10 | Lien permanent | Commentaires (2)
je te maudis
Je me tiens au bout de la falaise. Mes mains sont glissées dans la vareuse. Mes mains sont abîmées d’avoir construite de bois et de terre, cette maison pour nous deux. Pour que nous y lisions en paix. Pour que nous regardions grandir les enfants de nos femmes.
Et quand les nuages gris grondaient, je construisais.
Et quand les cloches de l’église appelaient les hommes en âge, je faisais le sourd.
Et quand je voyais déjà venir te chercher les bateaux, je construisais cette maison.
Je ne l’ai pas faite pour rire. Je l’ai bâtie aux vents, en lutte, en amour avec eux. Si tu t’en vas je me tais.
La guerre même sur les eaux me laissera sans voix, comme les animaux terrés, comme les idiots du village.
Je n’aurais plus de langage… Je n’aurais pas non plus la fierté du déserteur, j’aurais l’orage au cœur du frère de celui qui part.
Mais si tu t’en vas, si tu t’en vas vraiment, alors tu sors d’ici. De ce que je sais, les hommes ne reviennent pas. Ils vont, et vont d’un autre sens. Si tu t’en vas, tu n’es plus mon frère.
Donne leur ta force, tes poignets, tes épaules pour les fusils, mais oublie la maison qui retourne à la terre dès que je l’aurais dit.
Je m’assiérai calme, près du foyer, au bois brun de la bibliothèque. Je chercherai aux phrases des autres ce qu’il reste d’union et d’amour à sonder. Je ne guetterai pas ton retour.
Je suis debout, à la falaise, et ce n’est pas non plus ton départ que je guette.
19:09 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ne sois plus mon frère, bertrand belin, texte marie richeux, france culture, polaroid
.......................... (c) ROMAIN BERNINI ::: Europe second version

Le ciel est rose, il est tombé comme un rideau. Sur un volcan de Septembre.
Les parois s’effritent comme le temps en toute chose. Les parois, ocres et rocheuses d’un volcan où flotte le pétrole endormi. La surface du pétrole.
Ils ont des reflets bleus ce genre de liquide et prennent les hommes, comme le miel les abeilles, comme la merde les mouches.
Cet homme là croyait qu’en nageant, longtemps, même froide la flotte, même cassé le radeau, l’homme croyait qu’avec un peu d’effort de monnaie, ça irait l’Europe. Il irait jusqu’à elle, et comme une femme ronde et belle, elle l’accueillerait d’un baiser.
Mais c’est un baiser de la mort et maintenant c’est lui qui flotte. Le t-shirt jaune remonté sur son torse qui laisse voir sa peau brune, brûlée peut être.
La tête en arrière plongée dans le liquide, il respire il est mort, c’est le dormeur lui aussi, du val d’injustice. La peinture coule les larmes du quart monde, et heureusement c’est en couleurs, on y perdrait les nuances.
L’homme là, au volcan d’ocre, au ciel rose tombé comme un rideau, c’est de l’espoir qui coulait dans sa gorge.
18:50 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tableau romain bernini texte marie richeux
16 septembre 2011
octobre
moi je connais une Suzanne qui le portait pour nom.
15:20 | Lien permanent | Commentaires (3)
11 septembre 2011
on adoptait la vitesse approximative de quelque chose de lent regardé au ralenti
16:24 | Lien permanent | Commentaires (1)
c'est pas qu'on crie pas
Il existe une génération au pied du mur. Une génération devant laquelle ne se dresse pas de route, pas de carte de ces routes, pas même l’idée de ces routes. Il existe tout un tas d’êtres humains, qui d’hier à aujourd’hui n’ont pas vu passer le temps, qui croient périodiquement en l’amour, et qui l’instant d’après n’y croient plus. Ne savent manifestement pas pour qui voter demain, ni après demain d’ailleurs, et n’ont pas dans le cœur de cause à défendre. Il existe des centaines et des centaines de jeunes gens qui consultent davantage leurs mails que les nuages, qui n’ont pas d’âge et n’en auront qu’à 40 ans et ce sont ceux là qui naissaient quand on abolissait la peine de mort. Il existe aujourd’hui une génération qui ne se demande même pas à quand ce sera son tour, une génération qui n’a pas tout à fait trouver son vocabulaire.
C’est pas qu’on crie pas, qu’on n’écoute pas.
16:21 | Lien permanent | Commentaires (0)



