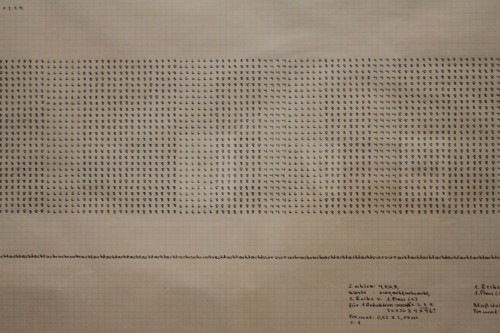28 novembre 2010
de quoi l'orage est-il le nom ?

Alors il ne reste plus rien. Ni au premier étage, ni au second / ni dans les combles, là haut, où une petite table de ferraille est installée. Les pieds se confondent au sol, se confondent au plafond, se confondent au mur. Sur la table sans ornement aucun, sans qu’un tapis ne fut glissé dessous, sans que l’on ait posé à côté une tasse de café chaud ou un livre entamé / Sur la table / trône ou dort une machine à écrire.
Aussi brune et rouillée que tout le reste est gris, elle semble être là depuis un temps indéfini mais long. Elle semble n’avoir accueilli aucune main inspirée, aucun clap sur ces touches, aucun ding, ring de fin de ligne.
Une machine à écrire et les lettres dans l’ordre que l’on connaît, lettres à présent muettes mais qui un jour - c’est certain - chantaient. Une feuille est glissée dedans, rentrée au trois quart dans les rouleaux. Elle attrape le seul et unique rayon de lumière, qui n’est pas le soleil mais autre chose qui brille.
On lit : « ce matin très tôt j’ai entendu que l’orage arrivait. L’orage c’est le ventre qui gronde, la pluie des infinis. Je suis allée voir si tout le monde dormait / je suis allée vérifier que les sommeils étaient paisibles, et je me suis assise à la table, la petite table d’où je t’écris pour entreprendre le jour, autrement qu’en baillant. Ce matin, j’attendais que l’orage ravage, que l’orage déplace, que l’orage… je faisais cela en tapant doucement sur les touches lisses et noires de la petite machine que tu connais »
La petite machine est toujours là, la lettre inachevée aussi. Tout est pris par le temps comme dans la cire. Personne ne sait personne ne dit, ce que ce matin là, l’orage a déplacé.
19:26 | Lien permanent | Commentaires (7)
si bientôt si jamais
On sonne la fermeture des portes. Le train intercité est bondé de monde et tandis qu’il démarre dans le silence le plus complet, nos corps balancent imperceptiblement au rythme de son moteur nouvelle génération. Une sorte de tourniquet nous permet de tenir debout, chacun trouvant pour sa main une poignée souple et désinfectée. La veste de mon voisin est incrustée d’un écran, écran sur lequel apparaît un visage. La veste de mon autre voisin est aussi incrustée d’un écran, écran sur lequel apparaît un autre visage. C’est donc cela que l’on regarde avec timidité. Une dizaine de petits rectangles plasma collés sur les parois du wagon qui auraient pu êtres des vitres, affichent des paysages urbains. Paysages qui défilent paisiblement de droite à gauche et donnent la parfaite illusion que nous les traversons effectivement. Des écrans au sol, comme un tapis lumineux, affichent des images colorées et brillantes, de paires de chaussures, pour tous les goûts, de toutes les tailles, dans toutes les matières que nous regardons aussi. Des hauts parleurs dissimulés nous glissent aux oreilles les informations du jour, ainsi que quelques anecdotes que nous pourrons raconter en arrivant. Une variation de lumière mime à la perfection l’entrée dans un tunnel, la sortie au grand jour. Un robot-écran, se déplace au milieu de tous, sans bruit mais tendant une écuelle en aluminium dans laquelle chacun glisse une pièce et un ticket. Tout le monde pourrait être quelqu’un d’autre. Il n’y a pas d’odeur, pas de sourire secret, pas de messes. Il pourrait être une toute autre heure dans une tout autre ville. Tout est réglé, rien ne dépasse, aucun corps ne touche aucun autre corps. Les écrans font écran.
19:12 | Lien permanent | Commentaires (3)
moderndédale
`
Parachutées de là haut, nous atterrissons, Nawal, Ariane et moi, au milieu d’une petite pièce que quatre portes encadrent. Chacune d’entre nous époussète son costume. Elise enfonce l’une des portes, qui grince évidemment.
Débute alors, une sorte de couloir aux parois plus que hautes au dessus duquel, tout de même, circulent les nuages. J’entends des rires. Des rires emmêlés à d’autres rires, encore emmêlés à d’autres. Des rires qui derrière les murs révèlent d’autres murs. Nous arrivons au bout du couloir. Prendre à droite ou à gauche, mais décider d’une direction. Je regarde Elise, Elise regarde Ariane, Ariane regarde ailleurs. Que cherche-t-on au juste ? Je tends l’oreille à nouveau…
Nous sommes mille dans ce labyrinthe.
Je glisse mes pas dans ceux de celle qui est devant moi. Nos vieilles chaussures soulèvent la poussière… Il n’est plus l’heure d’hésiter, il faut prendre à gauche, et voir. Il faut éprouver tous les chemins possibles, jusqu’à se trouver nez à nez au mur. Jusqu’à toucher le mur comme à l’aveugle. Sentir comme il est granuleux, épais, et opaque……… Et rebrousser chemin.
Prendre alors les devants. Inventer autre chose, une autre combinaison. Reprendre au tout début comme on remonte un rubycube. Crier aux autres - qui sont invisibles - de ne plus souffler, de ne plus râler contre le soleil qui tape. Dire aux autres, que leurs rires sont meilleurs guides que leurs désespoirs. Nous sommes mille dans ce labyrinthe. Le soleil tout en haut tape très fort et fait peser sur nos fronts une chaleur lourde comme de la fonte. Juste avant que nous n’abandonnions tout à l’heure, Ariane nous montrera du doigt la pelote de fil rouge qui depuis des heures se déroule derrière nous. Ariane, croyant s’en sortir indemne, sourira dans son coin.
19:12 | Lien permanent | Commentaires (3)
20 novembre 2010
à croire que le ciel est injuste.

Elle c’est Big Edie, 78 ans, large chapeau et joues qui tombent.
L’autre c’est Little Edie, 56 ans, recouverte de fond de teint et toujours affublée d’une garde robe moulante. Respectivement tante et cousine de Jackie Kennedy, elles vivent depuis des années dans une immense demeure de Long Island, devenue taudis.
Pauvre petite fille riche, de bientôt soixante ans, Little Edie se pavane dans d’immenses pièces en ruines. Changeant de tenue toutes les deux heures / Faisant appel à Dieu autant qu’au regard de sa mère qui pourrit dans de grands draps.
Elle a la tête toujours recouverte d’un fichu, à la manière de Jackie la lumineuse, la belle… Dans les années 30, elles posaient toutes deux sur les photos noir et blanc de l’aristocratie américaine… Depuis ,tous les rêves se sont évanouis. Edie n’est pas devenue actrice. Pas devenu chanteuse. Ne s’est pas marié avec un homme riche et célèbre. Elle est la face sombre du destin qui engloutie les âmes fragiles à qui l’on a trop fait miroiter la lumière/ et qui s’y sont brulé les ailes.
Sa mère, alitée et mauvaise - malade de quelque chose certainement - la regarde passive, comme on accepte, contraints, les spectacles interminables et maladroits des enfants le dimanche. Little Eddie, vieille petite danseuse, qui lorsqu’elle a trop froid, s’enveloppe d’un immense drapeau américain. Les étoiles n’ont pas voulu d’elle, mais qui régit les étoiles..? Alors que le show meurt doucement sous les particules de poussière, les grey gardens, mauvaises herbes, fleurs sauvages, rampent sur les murs de la maison américaine. Les étoiles n’ont pas voulu de toi Little Eddie mais qui régit les étoiles ?
17:24 | Lien permanent | Commentaires (5)
et le sol rebondissant
Il y a encore peu de temps c’était un terrain vague. Les cailloux roulaient sous les pieds des mômes et les plantes courageuses sortaient le nez au vent dès qu’un peu de sève leur montaient aux joues. Avant c’était sec et traversé de vent glacial. Parfois on y vendait des voitures en contrebandes. Le dimanche une à deux fois par an, c’est ici qu’elles créchaient avant de trouver preneur.
Maintenant, ils ont rempli le vide avec d’immenses barres d’immeubles, qu’ils avaient choisi pastel pour faire de la lumière et qui depuis ont déteint. Le vent s’en trouve empêché, mais le glacial, lui demeure. Beaucoup des familles qui habitaient les villages alentours furent regroupées ici, chacune à son étage - sans l’espace escompté mais avec l’eau courante et l’électricité.
En bas, une petite aire de jeux. Un toboggan, un bac à sable et quelques chevaux de bois qui n’ont pas très bien vieilli Un peu plus loin, quatre trampolines découpés dans un caoutchouc épais comme du bois, sur lesquels dix enfants s’envoient en l’air.
Leurs cheveux, toute couleur confondue, s’emmêlent dans leurs sauts. Leurs survêtements d’un autre âge forment des tableaux abstraits et nacrés. Ils volent. Et le paysage de béton qui reste derrière eux, stoïque, et leurs joues crasses, et leurs corps chétifs, et leurs mères trop fatiguées pour les entendre rire, n’enlèvent rien à la scène. Les grandes tours de béton projettent leurs cris à l’éternel.
C’est la seule et unique porte de sortie, qu’ils aient trouvé, pauvres anges. Celle du ciel ouvert. La gueule du loup. L’espoir trampoline et le sol rebondissant.
17:22 | Lien permanent | Commentaires (0)
17 novembre 2010
zone floue
Dimanche soir. Retour d’aéroport. Le bus remplace le train qui habituellement remplace les pieds. Comment peut-il déjà faire aussi noir ? Comment peut-on avoir en si peu de temps, perdu autant de lumière ?
Alors la banlieue nord se déchire sous les phares du 360. Plus que la banlieue en fait ! La banlieue, c’est vrai, on connaît. Ce que l’on connaît moins en revanche, ce sont ces zones industrielles. Zones creuses et floues, peuplées de grands bâtiments aux portiques automatiques, et aux parois gondolées.
A chaque arrêt, deux ou trois silhouettes emmitouflées grimpent, compostent tickets ou font sonner les badges, ôtent écharpes et autre larges bandes de tissu coloré pour s’asseoir en face ou à côté.
Ils sont fatigués. Mutiques. Rêveurs. Ils passent d’interminables coups de téléphone dans une langue qui nous échappe complètement. Ils sont partis pour traverser Paris. Changer à Gare du nord, attraper un RER, un autre bus, et rejoindre la petite ville qui abrite leur sommeil trop court. Ils viennent de faire quatre heures de ménage dans l’ensemble des bâtiments gris. Aspirateurs sous les bureaux, chiffons poussière sur les étagères, café à la machine et désodorisant au citron jaune.
Le bus 360, rapatrie aussi tous ceux qui ont atterri il y a une heure à l’aéroport, récupéré leurs bagages à roulettes et hésité pendant quelques minutes à prendre un taxi pour rentrer….
Bizarrement, ils sont extrêmement faciles à distinguer….
17:20 | Lien permanent | Commentaires (2)
16 novembre 2010
happy birth

Berlin. Novembre. Dix fois, depuis le matin, le ciel avait menacé de lui tomber sur la tête. Dix fois depuis le matin, le gris avait menacé de l’embarquer, toute menue qu’elle était, dans le gouffre mélancolique de l’automne. Dix fois elle avait résisté, aidé par un livre, aidé par les feuilles qui forment des matelas jaunes le longs des trottoirs, sauvée par un bâtiment aussi poétique qu’abandonné, et j’en passe. On lui avait donné rendez-vous à l’autre bout de la ville. Elle avait un temps pensé s’y rendre à pied, mais ses petites bottines avaient depuis longtemps pris l’eau, et afin qu’elle ne se retrouve pas toute entière noyée dedans, elle avait privilégié le bus. Berlin. Novembre. Huit fois la taille de Paris. Berlin, où tout se trouve à une distance décuplée de tout. Alors que le ciel allait, à l’épuisement ,parvenir à l’engloutir dans la tristesse, un homme, selon toutes apparences immigré turque du quartier turque, tenait dans ses mains un gâteau d’anniversaire. L’air tout ce qu’il y a de plus plastique. La crème pâtissière rose bonbon exagéré, et les biscuits en multicouche : alternance blanc de blanc et violet flashy. Personne ne se serait risqué à en deviner le parfum. Mais sur le dessus, dans une matière que nous laisserons incertaine, le portrait naïf, façon photo d’école, d’un garçon de dix ans. Ni plus ni moins dix ans, car c’était aussi marqué dans le sucre glace. Il avait les cheveux aussi noirs que ce que nous devinions être son père ou son oncle, ou son parrain que sais-je. Le gâteau n’était pas recouvert. Aussi, un seul coup de coude, aurait suffit à défigurer le garçon, à rompre la magie de ce dessus coloré et glacé. Mais rien de tout cela n’arriva. Sous ses yeux, tous les hommes, toutes les femmes, qui s’étaient bousculé jusqu’alors, se retirèrent sur son passage. Comme si il ne portait pas de gâteau d’anniversaire dans ses bras, mais un enfant en chair et en os, qui allait fêter l’âge symbolique de ses dix ans.
15:47 | Lien permanent | Commentaires (2)
ça sert à ça

Elle se tient comme à son habitude légèrement courbée. Penchée en avant comme pour venir au plus près du microphone. Une robe noire et moulée dessine son corps dont la taille est diminuée par celle de l’homme qu’elle appelle auprès d’elle. Il est grand. Il est aussi habillé de noir. Son visage fort, juvénile, frais, est un négatif de son visage à elle. Rond de vieillesse. Marqué. Fatigué. Malade déjà. Il se penche vers elle, le regard tendre, le regard englouti par cette femme de vingt ans son aînée. Evidemment rien ne les empêche. Ils transpirent de ce qui les unit. Secret pas du tout gardé, et donné à voir sur scène, comme une offrande sacrée.
Tous deux dressés devant le pied du micro ils chantent en alternance l’absurdité de l’amour. Ils articulent des couplets de chimères, mais aucune âme sur terre n’y croit plus qu’eux à cet instant là. Leurs sourires soulignent leurs inquiétudes. Elle lui fait la leçon, elle en a vu d’autre. Ce petit corps a brûlé mille fois. Ce petit corps, dont on finirait par douter qu’il abrite une voix si puissante, ce petit corps y a cru, à chaque nouveau printemps, aussi fort qu’au précédent. Toi tu es le premier, toi tu es le dernier. Ils ne le savent pas encore mais tout est vrai.
Elle ne regrette rien d’accord mais son cœur pèse lourd. Chacune des rides de son cou, raconte une histoire. Raconte les heures de braise où elle crut mourir d’aimer.
Mais elle est encore vivante et lui aussi, ça doit servir un peu à ça d’aimer.
11:58 | Lien permanent | Commentaires (4)
12 novembre 2010
faire mouche

Il est dix heures du matin. Tout est rangé. La vaisselle goutte tranquillement sur le tapis en mousse savamment étudié pour absorber le surplus. L’aspirateur ronfle dans le placard à produits. Le linge des enfants, est devant la porte. Un léger sifflement laisse présager que quelque chose boue dans la cuisine. La température est idéale. Dehors il fait frais, dedans il fait bon. Tout est équilibré, au milieu, tout est serein pour ne pas dire tiède. Elle a fait son boulot, coché toute les cases, c’est une bonne mère de famille. Elle a le droit de s’évader un peu.
Elle ôte ses deux chaussons au pied du tapis. Retresse ses cheveux d’une main habile et attrape un livre de l’autre. La véranda est baignée de lumière. La véranda n’est que vitres transparentes.
Soudain, le bruit d’une mouche. C’est rien le bruit d’une mouche. Mais la mouche veut sortir. Elle bourdonne, comme on trépigne. Elle se cogne, une fois puis deux, puis dix fois contre la vitre. La vitre est si bien lavée que l’arbre du champ paraît à portée d’ailes. La mouche rebrousse chemin, prend son élan, fait quelques ronds larges dans la salle. La femme la suit des yeux. Excédée, elle écoute le bourdonnement en priant pour qu’il s’arrête. Mais elle sait qu’au fond quelque chose les rapproche. Elle sait qu’elle bourdonne, elle aussi, à l’intérieur. Elle sait qu’à sa façon, elle se cogne souvent contre les vitres trop propres, trompée par l’illusion de la liberté.
Elle ouvre le bouquin, se force à lire et la mouche continue son concert désespéré.
Elle se demande alors au bout de combien de temps, combien d’heures de bourdonnement, combien de fois la tête cognée, une mouche réalise
que la fenêtre est fermée.
18:32 | Lien permanent | Commentaires (5)
10 novembre 2010
das baby

18:03 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photo, marie richeux
07 novembre 2010
....
Beyrouth, le ventre de Beyrouth secoué par les bombes. Le ventre de Beyrouth le souvenir est frais, mais les ruines le ravivent. Je suis assise à côté de Mehdi sur le matelas par terre. La fenêtre ouverte donne sur un paysage lunaire. La fenêtre n’a pas été ouverte pendant très longtemps. Le vent soulève des bâches en plastique qui protègent les bâtiments de la pluie, mais pourquoi.
- T’as pas une clope Mehdi ?
- Tu fumes ?
- T’as pas une clope ?
Mehdi fouille dans la poche de son manteau évanoui à même les couvertures. Sort un paquet rouge et blanc. Sort une cigarette, me la tends. Le silence de Beyrouth prend de la place entre nous, ne nous laissant aucun autre choix que de regarder ailleurs. Il y a des choses inexplicablement lourdes entre un frère et une sœur qui mériteraient, je sais pas, d’être dites, d’être ries, de faire quelque chose avec en tous cas, et cela, à la seule condition de n’avoir pas nos tous petits bras. Ca pèse, ce n’est pas forcément gris ou noir, ça l’est pas d’ailleurs, mais c’est suffisamment singulier et fragile, on devrait s’y pencher.
Nos cendres goûtent sur la moquette, qu’il faudra ramasser tout à l’heure. Mehdi me regarde. Je voudrais fouiller dans ses cheveux. Lui dire que plus rien n’est triste. Lui dire qu’on est vivant. Que c’est mon frère, que je n’en ai pas d’autre, tout ça. J’ai envie de lui toucher les oreilles, taper sur ses épaules. Mon ventre se serre quand je regarde la forme de sa bouche qui est sensiblement la même que la mienne. Si l’on y pense, aucun être vivant sur la planète ne m’est plus proche que Mehdi. Scientifiquement je veux dire. A l’origine. Personne ne me ressemble plus que lui, et cette chose est implicite et cette chose contamine, positivement, négativement, l’ensemble de notre relation. Où l’on voudrait gommer la ressemblance, le lien revient plus dru, plus rêche, apparent comme la racine. Comme s’il n’y avait pas le choix de se dépêtrer d’avec ses frères. Comme si c’était obligatoire.
C’est l’histoire ancestrale des hommes, c’est aussi l’histoire de Beyrouth.
20:03 | Lien permanent | Commentaires (2)
moite.
Cette musique dans le poste ça n’arrange pas l’affaire, ça rend les choses un peu mélo. Faut dire que la situation n’est pas aisée… Il a le bras qui dépasse de la fenêtre et un cheese-burger miniature qui dépasse du bras. Il est beau et classe malgré la fatigue. Les poches sous ses yeux ce sont les heures passées à retourner le problème dans tous les sens / en envisageant toutes les solutions, en considérant les forces en présence, mais parfois y a rien à faire. Ça ressemble trop à une impasse pour croire encore que la voie est libre. Une petite couronne en plastique clignotante est accrochée au rétroviseur. Elle porte bonheur… c’est un cadeau de ses filles…
Comme il est assis penché sur le volant, elle vient se mettre juste au dessus de sa tête. On dirait un jésus qui brille, un père noël, une fée en costard cravate….
Dans ses oreilles siffle encore le bruit des foules qui clament son prénom. Barack, Barack. Comment s’appelle-t-il déjà ? Et à quoi bon, et c’est quoi cette musique à la fin ?
Il n’est de prophète qu’en pays croyant, do you follow me n’est-ce pas ? Jusqu’à ce que le prophète ait les épaules trop lourdes. Jusqu’ à ce que les espoirs déchus pèsent outrageusement leurs poids. Jusqu’à ce que le premier président noir des Etats Unis ait l’herbe coupée sous le pied.
Il croque dans son cheese-burger, dernier sourire en bouche. Ni cynique, ni ironique. il ne prendra pas cette porte de sortie. Il pense à ce monde étrange si difficile à faire changer. Il pense que s’agiter devant des grands moulins a déjà épuisé don quichotte. Il soupire. Il ne baisse pas les bras sinon le cheese- burger tomberait…
20:03 | Lien permanent | Commentaires (3)
01 novembre 2010
lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux
La nationale la plus rectiligne du territoire français. Les platanes qui vont avec. La nuit. Très noire. Très compacte. Chocolatée. Une légère brume qui assoit l’ambiance. Le moteur dit combien on est seul. Les bandes blanches au sol autorisent ou interdisent à tour de rôle de doubler les voitures. Voitures qui de toutes façons ne sont pas là. Les platanes font comme un lit à barreau à travers lequel il serait tentant de passer, mais c’est interdit. Il faut rouler droit. En dehors des lignes c’est la nature. Il ne faut pas faire intrusion. Il ne faut pas déranger la nature sauvage, qui ne dort jamais, surtout quand vous roulez.
Votre pied enfonce la pédale. Ca blesse. Les freins crissent. Les pneus arrachent le sol, se débattent. Le bitume est brûlant. La biche vous regarde. Essoufflée. Elle est petite face à votre capot. Vous êtes tout petit face à elle. Le moteur respire fort. Qui est le plus apeuré des deux ?
L’animal, beauté soulignée par vos phares, reste statue, comme empaillée, le temps que vous repreniez votre souffle. Entre vos deux paires d’yeux, c’est l’éclair, la rencontre électrique. Et puis elle disparaît, dans un galop céleste, dans la nuit brumeuse et fraiche.
Demain, tout à l’heure, plus tard, vous ne serez plus certain de l’avoir vu.
19:56 | Lien permanent | Commentaires (1)
suivons le lapin blanc...
Un vieux rêve flotte dans vos cerveaux. Un que vous auriez fait au mois d’août. Un songe d’une nuit d’été, où tout se transforme, tout est théâtre. Dans ce rêve, personne ne se cachait derrière les arbres shakespeariens. Un lapin blanc, qui ressemblait à celui d’Alice, courrait à perdre haleine, répétant sans cesse que nous étions en retard. En retard, en retard, en retard. Dans ce rêve les présidents pouvaient être de toutes les couleurs, et, comble de l’inconscient, ils pouvaient même être des femmes. Le lapin nous chopait par le colbaque en répétant dieu que vous êtes retard, en retard, en retard ! Vous portiez un costume rayé de bleu de blanc et de rouge et ne cessiez de regarder autour de vous, ces choses étranges et enviables, qui n’étaient pas prêtes d’arriver dans vos contrées.
18:46 | Lien permanent | Commentaires (7)
au bout des flèches.
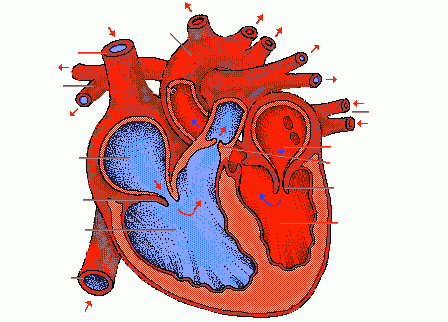
18:39 | Lien permanent | Commentaires (4)
30 octobre 2010
.
dormir-comm-une-marmotte-sous-morphine
10:35 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marie richeux, texte
quand le dentiste était parti
10:24 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, image
correspondance
Paris 15 avril 1860, Ta Marie chérie.
Mon Eugène, je vole quelques minutes à l’aube pour t’écrire cette missive. Il fait étrangement froid pour avril et même la moindre chaleur de la lampe à pétrole me console. Je porte ta vieille veste de laine elle me fait de grand bras. J’aimerais qu’ils fussent suffisamment grands pour t’y bercer mon tendre. Cet océan d’oubli et d’hiver qui s’étend entre nous me noie depuis des mois et j’y ajoute les larmes. Je passe mes journées entières à la laverie. Madame Doutais est tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais nous avons du travail.
Mes nuits ne ressemblent à rien sinon l’inquiétude de te savoir là bas dans quelque chose de si grand que j’en oublie le nom.
Je suis ridicule mais je jalouse cette montagne que tu creuses de tes mains. Ridicule mais je jalouse le vent qui te fait les joues rouges. Je hais les hommes qui partagent ton quotidien et cette pauvreté d’ici qui te fit partir là-bas.
On dit qu’en Amérique, la gangrène guette les aventuriers je meurs de te savoir malade. Ecris moi.
On dit qu’en Amérique, les femmes guettent les aventuriers, je meurs de te savoir épris. Ecris moi, Eugène.
Il m’importe bien peu que tu reviennes riche, tant que la pierre ne t’a pas assommé, que la maladie ne t’as pas rongé le torse. Il m’importe bien peu ce que tu as ou non dans ton petit sac de cuir noir. C’est une idiotie que d’être parti si loin.
Je t’aime idiot, je grelotte et je t’aime. Rien n’est vrai que cela, écris moi.
10:13 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, texte
27 octobre 2010
free from larry. comme promis.
Ils ont seize ans. Cela fait vingt quatre heures qu’ils ne sont pas rentrés chez eux. Fumer des joints et faire du skate-board sur le bitume brûlant de Los Angeles n’attend pas une seconde et prend du temps. Affamés, assoiffés, ils gravissent quatre à quatre les escaliers de l’immeuble, le pantalon baggy leur tombe sur les fesses et ils manquent à chaque marche de se prendre les pieds dedans.
Ils écrasent sur le palier les cigarettes qu’ils gardaient collées au coin des lèvres. Leurs planches à roulettes dépassent de leurs sacs à dos. Ils ont l’air de tortue, ils ont l’air de campeurs, ils sentent la transpiration et mâchent un vieux chewing-gum.
Tom appuie sur la sonnette comme pour l’enfoncer dans le mur. Une femme vient ouvrir, elle aussi la clope au bec, l’air pas beaucoup vieille au final, et le corps d’un nourrisson posé sur ses hanches comme un petit animal.
C’est la mère de Tom. Qui fait demi tour, qui ne dit pas bonjour, qui flotte elle aussi dans un pantalon trop grand. Qui est fatiguée, et qui n’a pas les quelques dollars que Tom s’empresse de lui réclamer pour argent de poche.
Au bout du couloir, comme souvent, la cuisine, dans laquelle les deux grands dadets la suivent, se jetant furieux sur le frigidaire et descendant en une gorgée ce que nous aurions mis une semaine à boire. Tom disparaît aussitôt dans la petite chambre qui jouxte la cuisine, tandis que Clay, refermant discretos la porte du frigo, reste quelques secondes accoudé au mur. Le regard timidement puis très clairement posé sur la poitrine offerte de la mère de Tom, en train d’allaiter le tout petit dernier. Celui-là dort à moitié, mais le léger sourire inscrit sur ses lèvres porte à croire que les deux sont complices. L’un profitant du lait nourrissant de sa mère, l’autre de la vue hallucinogène d’un sein rond, lisse et gonflé.
09:58 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marie richeux, texte
26 octobre 2010
grappes de raisins noirs.

C’est une histoire de brigands, dans le New-York des années quarante. Où les soirs fument, les gens fument, les rues fument. Aujourd’hui on enterre le boss. Sorte de patron d'une mafia quelconque, mort de vieillesse, après qui il va falloir tout réorganiser. Le pouvoir et l’amour.
Les types sont habillés de noir et portent des lunettes. Six d’entre eux soutiennent sur leurs épaules carrées le cercueil en bois brun et aux poignées dorées. Les femmes marchent plus loin, grappes de raisins noirs, plus belles les unes que les autres, les yeux fardés de sombre. Les dentelles se confondent au velours. Leurs cheveux sont remontés en chignon, rond dodu dans un filet cachés sous des capes de mousseline. Elles se regardent en coin. L’une fut l’amante, l’autre la mère, l’autre encore l’officielle, l’amour, la patronne. Le cimetière et les larmes expédiés, tous se retrouvent dans un vieux bistrot et tous se remettent à fumer et à boire. Ils négocient la suite.
Les femmes, petites grappes sombres, demeurent mutiques et mystérieuses, elles se sont installées au fond, dos au miroir, qui reflète leur masse opaque. Les hommes occupent les tables centrales qu’ils ont regroupées pour un banquet macabre. Le partage d’héritage est déjà sur le tapis.
Le patron derrière le bar, semble sur le qui-vive. Il sait que sous les costards ajustés dorment d’un demi sommeil, les revolvers chargés. Il sait que demain au plus tard les affaires reprendront et que sans chef, les affaires seront sanglantes. Il voudrait que son café n’en soit pas le quartier général. Alors que le vieux Juke box balance du Fitzgerald, les femmes se lèvent une par une, et défilent sous le porche. Elles sont une partie de l’héritage et le savent. La tête haute, elles savent aussi que rien ne se fera sans elles.
10:10 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : marie richeux, photo, texte