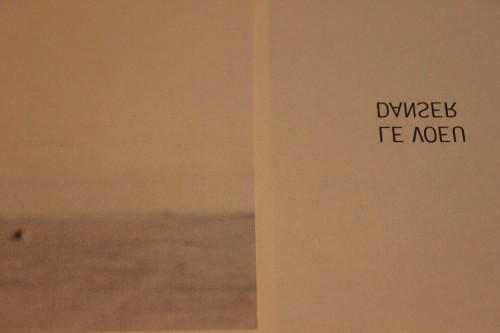23 octobre 2010
on est sérieux quand on a dix sept ans

Ils ont bravé l’interdiction. Il est trois heures et quart du matin. Ils ont bravé toutes les interdictions en même temps, autant faire les choses vraiment. Ils sont assis sur le plan de travail de la cuisine collective. Ils y ont fait tenir une bougie de cire blanche qui dégouline. La flamme les éclaire par intermittence. Ils ont des visages d’enfants malgré les dix sept berges qu’ils défendent fièrement. Ils ont tous une clope au bec et s’apprêtent à engloutir le reste des desserts mal rangés. L’étage des filles, au troisième est séparé de celui des garçons, au quatrième. A partir d’une certaine heure il est interdit de descendre ou de monter. Mais c’est justement à partir de cette certaine heure qu’il est urgent, brûlant, de descendre et de monter. Dans les lits superposés là haut, ils ont joué la carte des oreillers qui donnent l’illusion des corps et il y a un puni, tiré au sort, qui est resté pour faire le guet. Hortense, Nico, Flore, Greg, Nadia, Philomène, Youssef, Jeremie, Noham. Ils sont sérieux. On est sérieux quand on a dix sept ans, non ? Ils ne le savent pas encore mais c’est leur dernière colonie de vacances. Dans trois jours lorsqu’ils seront sur le quai de la gare, que leurs parents les épieront de loin, ils pleureront toutes les larmes de leurs corps, parce qu’on est sérieux quand on a dix sept ans, non ? Pour l’instant Fred et Léa font l’inventaire des plus mauvaises blagues de la journée, Youssef regarde dans le vide à moins qu’il ne regarde Philomène. Noham cherche un tournevis pour démonter la hotte, pour voir. Nadia se souvient qu’elle n’a pas posté la carte postale pour son vieux père. C’est bête à dire mais ils sont super beaux. C’est fou comme ce genre d’images vous reste collé sur les parois du crâne. C’est fou comme elles vous paraissent appartenir à un autre monde, vingt cinq ans plus tard. Une rengaine dont on a perdu le refrain, une ritournelle sans rivage…
12:11 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : photo, marie richeux, texte
21 octobre 2010
suivant la pente hasardeuse des choses de la vie
Ils étaient quatre frères. Mars, Frédo, Hyppolite et Gustave. Chacun était né moins d’un an après l’autre, sauf le premier évidemment. En même temps avec un nom pareil il ne pouvait que venir d’ailleurs.
Mars nourrissait depuis toujours une passion pour tous les engins à moteur. A commencer par le rasoir électrique de son père, la tondeuse à gazon, plus tard les mobylettes évidemment et encore plus tard, ce qui est déterminant pour l’image qui suit, la caméra super 8 de son jeune frère Gustave.
Faute de n’avoir su apprendre à temps et par cœur les verbes du premier, du second et du troisième groupe,
Faute de n’avoir pas tout à fait adhéré à la version ultra libérale des cours de géographie de Madame Graffin,
Faute d’avoir trop souvent voulu initier une révolution silencieuse mais néanmoins révolutionnaire, Mars s’était fait viré du collège. Puis d’un autre collège, puis d’un dernier collège, et puis il avait eu seize ans et tout le monde avait été soulagé de pouvoir l’extraire su système scolaire.
Tout le monde, sauf sa pauvre mère. Quoique.
Mars n’avait alors plus quitté le garage de la maison familiale, et petit à petit tous les types du village - quelques demoiselles les jours de chance - lui apportaient leurs mobylettes et scooter en panne pour leur refaire une santé. Mars gagnait son pain.
Son cadet, le petit Gustave assistait après l’école aux séances de réparation. Il nourrissait lui une passion pour l’image qu’il captait sans fin à l’aide de la super 8 offert par l’oncle Sztern. L’oncle Sztern ayant des vues sur la mère, mais ça c’est une autre histoire.
La caméra tomba en panne un jour, Gustave demanda à Mars de la réparer ce que Mars fit en échange de… En échange d’une petite projection à destination des clients chauffeurs de bolides, un dimanche après midi par mois.
C’est ainsi que, petit à petit, et suivant la pente hasardeuse des choses de la vie, le garage familial et peu accueillant des quatre frères devint le cinéma du village, lieu d’ouverture et d’émerveillement pour le trois cent cinquante sept habitants de Thiévert.
Village qui évidemment, n’existe pas, ou alors à notre insu….
15:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
19 octobre 2010
la seconde surprise de l'amour

Personne n’a fait le coup de la panne à personne. Si l’ascenseur se trouve coincé entre le quatrième et le cinquième étage c’est une simple question de mécanique. Une histoire de câble mal enclenché mal fichu qui s’est pris dans la poulie. Il faut dire que l’appareil n’est pas tout neuf. Il n’y a qu’ à voir les lignes blanches qui strient la moquette des parois, on croirait les rides d’un arbre qui indiquent son âge lorsqu’on en scie le tronc. La moquette est d’origine. L’ascenseur aussi.
Au premier rebond, Kate avait senti son cœur opérer un brusque va et vient. De bas en haut suivant le mouvement de la cage d’ascenseur elle même, et là aussi selon une simple question de mécanique. L’émoi avait fait naître quelques taches de rousseurs sur sa peau à l’habitude si blanche /et Kate avait rattrapé de justesse un petit hoquet nerveux. Notez que ses cheveux étaient encore mouillés et gouttaient par mégarde sur le plancher de bois.
Léo, lui, avait simplement posé une main près des boutons d’étage, pour se retenir de tomber. La brutalité de l’arrêt lui ayant fait perdre l’équilibre. Cette main était venue, simple question de mécanique, frôler l’épaule de Kate. Légèrement mouillée elle aussi, vous savez pourquoi.
Le petit haut parleur, qui lui n’était pas d’origine, continuait de crachoter non pas une musique d’ascenseur, mais celle d’un orchestre triste et néanmoins vaillant, qui se serait mis à jouer sur le pont d’un bateau monumental prêt à sombrer dans l’eau. La mélodie épique fit songer à nos deux naufragés de la cage d’ascenseur qu’ils s’étaient peut être déjà rencontrés dans une vie antérieure. Une vie où Léo l’aurait pris par la taille sur la proue d’un bateau en lui disant qu’elle était une reine. Une vie antérieure beaucoup plus sirupeuse, vraiment antérieure. Bref, l’idée ne manqua pas de rajouter aux rougeurs sur les joues de Kate, dont les lèvres, simple question de mécanique, se trouvaient si près si près de celles de Léo, qu’on aurait juré à un futur baiser de cinéma.
05:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
14 octobre 2010
yeah yeah
Attention boule à facettes, et spotlights de toutes les couleurs ! Le plancher est lisse et brillant. Autour de la piste les chaises en bois sont disposées de façon extrêmement soignée. Quelques jeunes gens en costumes-cravates, tapent du pied, mâchent du chewing gum et fument des cigarettes en y mettant le ton.
Sur l’estrade, l’orchestre est au mieux de sa forme. Batteur, contrebassiste, chanteur belle gueule, tous endimanchés du même deux pièces noir et blanc / et chaussures vernies bicolores sur chaussettes repassées. Leurs cheveux sont tirés en arrière, gominés noir et brillants ce qui élargit passablement leurs fronts.
Rock n’roll ! Ils n’ont que ce mot là en bouche. Les do you love me baby, les déhanchés bien vus en cadence. Les swap bap, blue shoes. L’insouciance règne, les Etats Unis aussi. Il est l’heure d’être beau, il est l’heure de draguer sa voisine, l’heure de tester son nouveau passe-passe. Le contrebassiste est penché sur son instrument, comme Mike l’est sur Daisy, comme Teddy l’est sur Olfa, comme Mathias louche sur Jennifer.
Ces deux là, justement, aux vêtements accordés, se jettent sur la piste profitant d’un petit creux. Mathias, dans l’élan, fait tournoyer sa partenaire. Attrape ses hanches, ses minuscules poignets. La fait passer en dessous de ses bras fraichement remusclés. Son brushing est parfait, le haut de ses cheveux crêpés et noués par un tissu rose bonbon. Rose bonbon que reprend la robe, au décolleté discret mais affriolant. Le batteur se lance dans un solo mémorable, bientôt rejoint par le contrebassiste. Ils soutiennent et encouragent les deux danseurs à présent seuls en piste.
Un coup de cymbale et Jennifer est projetée dans les étoiles… le mouvement laisse entrevoir ses cuisses fermes et blanches. Elle manque un instant de percuter la boule à facettes, mais garde le sourire, ultra Bright à toute épreuve. Elle atterrit comme prévu dans les bras de Mathias qui ne manque pas d’en rajouter. C’est ici que le rythme se casse et la chanson bascule comme si de rien n’était en un slow langoureux. Le genre de choses qui surprend les filles en robe meringue, le genre de chose que savent très bien faire les gars de l'orchestre.Il faut dire que Mathias est très très copain avec les gars de l’orchestre…
15:59 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : photo, marie richeux, texte
quid de sisyphe?
La roche est somptueuse, orange. Tellement orange que rouge parfois… La lumière s’y cogne et des morceaux lumineux s’en détachent, dégringolent dans la vallée. Des pépites dorées qui se fondent à la boue noire près de la rivière. Quelques oiseaux survolent l’immensité avec l’air de ne vouloir déranger personne. Leurs cris déchirent parfois le silence qui au final ne demande que ça. Le somment culmine à plus de deux mille cinq cent mètres. Au plus bas, la température avoisine les cinquante degrés. En haut, le souvenir de la neige n’est pas encore tout à fait défait.
Un homme, recouvert de cette couleur omniprésente, ocre lui même jusqu’à la peau rugueuse de ses joues, a les mains posées sur une sorte de brouette en ferraille. La brouette seule a déjà l’air très lourde. Ce métal épais, rongé par les rares pluies et le temps, métal recouvert d’un sable fin, donnant lui aussi dans les tons oranges.
Des gouttes de sueur salées lui perlent sur les tempes, qui battent la chamade en écho avec le cœur. Il pousse son engin rempli de terre à ras bord. Les muscles de ses bras sont saillants, rappelant le dessin de l’eau de la rivière. Il s’arrête tous les cinquante mètres quand la montagne le permet, offre une légère plateforme. Alors il passe sa manche de chemise sur son front pour éponger cette eau qui l’empêche de voir. Reprend son souffle, qu’il a court de toutes façons, et replace ses mains sur le guidon de la brouette et pousse, pousse. Le sommet paraît s’éloigner à mesure qu’il avance et pourtant, il y parvient enfin. A peine le temps de regarder alentour, se dire combien le ciel est complet, dense, offert. A peine le temps de croire que sa peine prend fin, que demain sera un vrai jour ouvert, de liberté, que l’engin dégringole, en déversant la terre pour finir sa chute dans le creux de la vallée. Il redescend, le récupère et reprend l'ascension. Enfin vous connaissez à peu près l’histoire.
15:55 | Lien permanent | Commentaires (4)
08 octobre 2010
dialogue de murs

Errance dans les hauteurs d’Alger. Bab el Oued. Grand décor.
Une maison à droite, une maison après le virage à gauche, un mur, une éternité des murs blancs derrière lesquels se cachent … on ne sait pas. Rue en lacets, impression de montagne. La baie se détache derrière un port industriel que l’on avait oublié de regarder. Passé le dernier virage, soudain c’est beaucoup plus grand, soudain c’est au dessus de nous et tout autour, ça ressemble à quelque chose que l’on connaît tellement qu’il en est impossible à décrire. Le béton est sali et ajouré par endroit. Les fenêtres, voilà les fenêtres que l’on connaît par cœur : petites cases colorées, soulignées par des pare soleil, des rideaux rapiécés. La cour paraît immense, immense mais habitée. Une petite ville grouillante en échelle miniature… Là une table avec des fruits, là un mécano improvisé, ici quelques trafics illégaux et là encore trois femmes rondes entourées de voile. Les bagnoles dorment en bas, rangées en mauvaise file. Par cœur, on connaît ça par cœur. Quelque chose bat en nous différemment, comme si dans les yeux se superposaient la découverte et l’immense familiarité. La même sensation que la convocation d’un souvenir et pourtant, c’est la première fois que l’on voit cet endroit.
Au milieu des années 50, l’architecte Fernand Pouillon se voit confier la construction d’une cité en lieu et place d’un bidonville à Alger. Quelques années plus tard, il participe à la construction de plusieurs ensembles d’immeubles à Meudon la Forêt près de Paris. Ville de l’adolescence. Voilà on y est. mais ça on l’a su après, en rentrant. Comme quoi les yeux se chargent parfois de tirer sans nous les fils de nos histoires et de les emmêler à souhait.
Les deux bâtiments ont vieilli différemment et c’est un autre sujet. Mais de part et d’autre de la méditerranée, les murs résonnent.
09:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
06 octobre 2010
demandez la deuxième
Ce n’est pas encore l’aube. C’est l’heure bâtarde mais magnifique que je commence à connaître, entre la nuit noire et le timide début de quelque chose. Capitale. Nord est de Paris. Sur le terre-plein du boulevard, quelques femmes marchent, c’est ainsi qu’on les appelle, les marcheuses. Chinoises pour la plupart, elles portent une mince doudoune noire ajustée sur un jean. Pas d’extravagance, juste une permanente qui frise les cheveux habituellement lisses, et un brin de maquillage pour souligner les yeux et la bouche. A même le sol, des hommes étalent des morceaux de tissu dont on ne voit pas la couleur et peu importe d’ailleurs. Ils sortent de leurs sacs à dos une multitude de fils électriques, lesquels sont repliés sur eux même à l’image des enfants qui dorment encore à cette heure ci. Ils sortent aussi des postes radio d’un autre âge, une veste en laine, trois ceintures.
Celui-là a étalé devant lui une collection de chaussures uniques, en plutôt bon état dont on se demande vraiment au fond, si la seconde, celle qui ferait la paire attend dans le sac à dos… tant ce petit marché illégal et secret ne ressemble à aucun.
Si tôt déjà, d’autres hommes les éclairent avec une lampe torche que cherchent-ils ? Les lumières donnent à la scène une allure irréelle, oscillant vite entre le rêve étrange et le cauchemar. Même les immeubles font figure de drôles des monstres, des gardiens de la ville, des veilleurs de nuit. Ils surveillent ce paysage : des femmes marcheuses à la recherche d’hommes en mal de corps à serrer, et des hommes debout, les chiffonniers, devant leurs étals improvisé, les yeux sur leur mince marchandise.
Rien que de très normal pour une nuit bellevilloise. C’est sur ce territoire mutant, inapproprié, précaire et parfois dangereux qui la débrouille pour le dire gentiment, les amène à quatre heures du matin… Certains prient secrètement pour la lumière du jour.
09:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
05 octobre 2010
les cadeaux qu'on me fait.
"comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd'hui, que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève (...) cela a un très beau nom cela s'appelle " E L E C T R E / G I R A U D O U X
05:49 | Lien permanent | Commentaires (3)
très très grande collection
05:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photo, marie richeux, texte
03 octobre 2010
motif récurrent
05:37 | Lien permanent | Commentaires (0)
01 octobre 2010
n'importe où finalement.
C’est une forêt ultramoderne, étirée par le haut du crane. Une multitude d’étages à deux chiffres… C’est une forêt qui a tout de la jungle imaginée il y a des années par les auteurs de science fiction les plus fous. Les flots humains sont parfaitement organisés et répondent pourtant à un immense chaos. La plupart des passants à cette heure porte un uniforme soit pour aller travailler soit pour aller à l’école. Il se dégage de leur marche une énergie folle que l’on peinerait à contrôler si elle était libérée, éparpillée, relâchée dans la nature / mais dans cette ville / elle ne déborde pas. Elle est contenue bouillante. Les pas qui tapent, bruit blanc sur le bitume, produisent à coup sûr de l’électricité, électricité, utilisée pour alimenter les panneaux publicitaires géants qui empêchent le ciel d’exister. De temps en temps des voix féminines sorties de nulle part, indiquent qu’il faut aller par là, ou par ici, ou encore descendre en prenant garde à la marche. Tout le monde danse en fait, une chorégraphie pareille à celle des militaires, on l’on attendrait que quelqu’un sorte du rang.
Au milieu de ce bal millimétré, au beau milieu d’un passage piéton zébré de blanc, un homme porte à l’épaule une caméra couleur aluminium. Son pantalon est un ensemble de poches, lesquelles poches sont remplies d’accessoires… Les passants le contournent, le bousculent parfois, mais semblent toujours l’éviter du regard.
Le regard pourtant, voilà ce qui le meut, voilà ce qui de temps en temps lui fait un pas sur la droite ou quelques pas devant. Il fend la foule sans ôter son œil de l’appareil, le deuxième œil est fermé, créant des rides sur son front juvénile. Comment avance-t-il alors, comment ne tombe-t-il pas ? Il est possédé par ce qu’il filme, induit dans le mouvement de cette ville et des milliers de silhouettes. Porté par sa petite musique intérieure, et un battement sourd et secret.
05:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
28 septembre 2010
voeu pieu - livre à venir - a-v-e-n-i-r
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
l'enjeu
Périphérie de Tunis. Le terrain de football. Faute d’une pelouse élégamment tondue à ras, une surface jaune de terre battue à l’ancienne, où les cailloux volent sous les coups de pieds maladroits. Le ballon, lui, est très brillant (noir et argent) et porte le logo qu’il faut, là où il faut. Les gars qui arrivent troquent leurs jeans contre shorts et maillots aux couleurs de l’équipe nationale. La matinée avançant le terrain compte bientôt les vingt deux joueurs règlementaires, et chaque nouveau candidat à la balle se fend du même nombre d’accolades avant de se lancer dans des étirements…
Autour d’eux le beige initial des immeubles a pris un coup de vieux. Les façades sont ornées de la forêt habituelle des antennes satellites et des linges colorés. Quelques toits se terminent dans de grandes tiges de ferraille, promesse d’un étage supérieur ou d’une échelle pour les étoiles.
Des bancs fatigués font office de tribunes. Ceux qui, las du travail nocturne, préfèrent la farniente à la drible, s’y prélassent en grappe et ils sont nombreux… à parler fort… à s’improviser commentateurs sportifs… vantant les prouesses de celui-ci, ou raillant le pied crochu de celui là.
« Farid, ça te sert plus à rien de courir après la balle, tes jambes elles sont possédées par le shétan »
A les entendre on se dit que le match se joue peut être là. Dans la joute verbale des pseudos supporters. La coupe irait à celui qui fort de ses bons mots, aura fait rire plus haut ses acolytes.
A moins que le match ne se joue vraiment autre part. Sur les bancs d’en face, tout aussi fatigués, tout aussi tribunes mais féminines celles-ci… Où viennent de prendre place trois jeunes femmes au jogging nonchalamment posé sur les hanches. Les cheveux noirs tirés / tout droit sortis du brushing et retenus haut par une pince en plastique rose fluo. Elles font mine de ne pas prêter attention aux jongleries de ces messieurs, mais jettent quand même un œil, lorsqu’ils hurlent et ôtent le maillont pour un nouveau point marqué… rien de neuf sous le soleil en somme….
20:24 | Lien permanent | Commentaires (0)
24 septembre 2010
par pure tradition
C’était un vieux village. Un vieux vieux vieux village…. De tout temps on le survolait à bord des coucous, regardant sa terre sèche se craqueler de partout. C’était une terre habitée, au grand sens du terme. Une terre magique. Comme dans les jeux d’avant, tout habitant était doté d’une vie supplémentaire. Pour réessayer, mieux ou moins bien, en prévision des actes manqués.
Bref, un village aux règles souples et immuables, imaginé pour et par les hommes, avec l’injonction raisonnable de réinventer toujours.
Puis, vint l’heure incongrue et absurde de la séparation. Une ligne fut tracée dans la terre sèche, une ligne médiane, une tranchée pas bien profonde. De la-haut, à bord des coucous toujours, le village tout rond n’était plus que moitiés. Les maisons se répartissaient de chaque côté de la ligne et les anciens voisins se définissaient à présent toujours en fonction d’elle. Certains habitaient à droite et les autres habitaient à gauche. Les anciens voisins se trouvèrent des différences, des nouvelles habitudes. Bientôt même le climat changea au dessus des deux parties. Quand le soleil surplombait l’une, l’autre était arrosée par l’orage, et chacune des deux nouvelles populations se réjouissait de ce dont elle était dotée. Le temps passait et creusait artificiellement les différences.
Et puis vint un autre jour. En survolant le village, de nos coucous toujours, on vit les habitants sortir de chez eux, un par un, certains par grappes. Une mère, quelques enfants, une bande de jeunes gens, des hommes. Ils sortaient des maisons par les petites portes et se mettaient en marche. Semblable à des insectes d’abord éparpillés, puis en rang, ils prirent la même direction, celle de la frontière du milieu. Leurs pas résonnaient faisait trembler les murs. Plus ils se rapprochaient de la ligne plus ils étaient nombreux.
Ils formaient bientôt une sorte de file, qui soulignait leur ressemblance à tous. Ils n’entrèrent pas en collision. Au lieu de cela ils se mirent à marcher tous ensemble sur la ligne précisément, au milieu. Et les jours qui suivirent ils déplacèrent les maisons, les arbres, les murets, les chemins… au milieu.
Et les jours qui suivirent le milieu s’épaissit, s’épaissit encore, s’élargit tant et si bien qu’il reprit la forme du village, l’ancien village. le leur à tous.
20:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
16 septembre 2010
les deux font la paire
On mentirait en disant qu’on ne les avait pas remarqué. On ne voit qu’eux. La scène n’a plus d’âge. Lui 14 ans et elle presque treize. Ils sont assis sur un bloc de béton gris tacheté. Des baskets multicolores et rebondissantes leur pendent aux chevilles. Ils font semblant de parler d’autre chose. Se taquinent, se moquent des passants :
- t’as vu celui-là avec sa barbichette et ses lunettes façon laboratoire, ma parole on dirait l’père de Pinocchio !
Heureusement qu’il y a les passants... On se dit quoi déjà à la place des vrais mots ? Il lui raconte les derniers coups qu’il a fait avec sa petite bande d’apprentis voyous, y met les gestes et les gros mots. Elle fait semblant d’être impressionnée, balance de façon irrégulière ses deux pieds dans le vide, se gratte le cou, l’oreille, la joue, le sourcil, renifle. Elle ronge ses ongles mal peints et fais des petits dessins avec sa clef rouillée sur la croute de béton gris.
Tout à l’heure, il lui demandera à quoi elle pense, et elle répondra qu’elle pense à rien, pourquoi ?
Tout autour d’eux les immeubles attrapent ce qu’il reste de lumière en cet après midi d’automne. Quelques femmes se disputent les nouvelles du jour près des boîtes aux lettres un peu plus loin. Et quelques enfants font mine de ne pas s’ennuyer. Lorsque le silence les assomme tous les deux, il sortent un téléphone, un truc à tripoter, regardent ailleurs, regardent les arbres. Ici c’est la cité des Tilleuls, c’est joli comme nom pour un rendez-vous…
Oui mais c’est pas un rendez-vous.
Il sort de sa poche un petit walkman dont il semble très fier, gagne du temps en démêlant les fils des écouteurs. S’approche un peu d’elle pour lui glisser une oreillette.
Il, 14 ans, lui demande à elle , bientôt 13, à quoi elle pense.
et elle, bientôt treize, elle dit qu’elle pense à rien, pourquoi ?
13:39 | Lien permanent | Commentaires (10)
temporaire

Le jour était tombé depuis des lustres maintenant. Ils n’en avaient plus le souvenir. Ils marchaient près de la côte, leurs pas faisaient de temps à autre,glisser quelques cailloux dans le ravin. Ils devinaient ce qu’ils ne voyaient plus. La mer grise ou noire à une heure pareille, les rouleaux rugissant, dont il ne resterait demain que la trace de la marée. Et les rochers qui tombaient à pic et faisaient à la Manche de bien drôles d’oreille. La lune était là évidemment, lampadaire esseulé, trouant le ciel de sa gueule pâle. Ca leur faisait drôle de marcher ici. Comme si leurs pieds reconnaissaient….
Le paysage leur allait à la manière d’un vieux costume. Malgré l’étroitesse et la dangerosité du chemin, ils n’avaient pas à réfléchir pour mettre un pied devant l’autre, ils connaissaient ça. Combien de fois enfants, avaient-ils couru après un chien, un seau de crevettes savamment extraites des rochers dans chaque main ? Combien de fois avaient-ils manqué de se casser la figure, sous le regard terrifié d’un plus vieux, d’une plus vieille.
Ils arrivaient bientôt tout près des barrières. De chiches piquets de bois que l’on avait mis là pour empêcher la dune d’avancer.
Dos aux vagues, les deux épaules tournées vers les terres, ils aperçurent la caravane. Deuxième point de lumière, jaune cette fois, dans la nuit noire et fragile.
La caravane, ou quatre petites fenêtres découpées sur un terrain que l’on croyait désert au prime abord. Une éternité d’herbes sauvages….
La caravane où devait se préparer une soupe épaisse et chaude, faite de lentilles et de quelques viandes….
Ils s’approchaient encore et virent le terrain, cet immense champ en friche, se parer de mille et une loupiotes. Maisons temporaires sur roues. Maisons aux lumières jaunes et aux odeurs de soupe similaires. Leurs pas se fit plus secret. Leurs deux silhouettes de jeunes hommes définies par la lune. C’était chez eux, pour un temps. De nouveau et comme avant.
13:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, marie richeux, texte
08 septembre 2010
hou !
On comptait sept tables nappées de carreaux vichy plastique. Sept tables qui séparaient les autres convives du type du fond. Il mangeait ce qu’on lui apportait à une allure minimaliste, mais mangeait tout. Des petites assiettes gondolées en inox s’empilaient devant lui, bâtissant sans le savoir une muraille de fortune. L’atmosphère était celle des diners très longs chez Solange, tout le monde se connaissait peu ou prou, de temps en temps fusaient quelques mots entre les tables, de tendres injure . Solange trimballait son gros cul et son tablier de clients en clients, offrant un sourire généreux à chacun et surtout des petits plats en sauces. La terrasse était recouverte d’une tonnelle épaisse, sorte de vigne sauvage, qui aurait en plein jour fait croire à la nuit.
Il était bientôt onze heures du soir, les âmes attablées bien imbibées d’alcools. Ils riaient plus ou mois fort, mais riaient globalement. Sauf lui. Il finit sa dernière assiette et la poussa du bout du coude près des autres. Il piocha dans une vieille sacoche un livre abîmé qu’il ouvra sans marque page. Dès lors il sembla disparaître. Ce qui jusqu’à maintenant dessinait à grands traits ses contours, sa silhouette, devint flou et on se savait plus si quelqu’un était assis là.
Une autre heure passa, une heure faite de soixante minutes irréelles, durant lesquelles le monde flotta, reproduisant la façon dont les mots du livre le faisaient tanguer.
Soudain une lumière traversa la tonnelle, une lumière venue de l’appartement du haut. Brusque. L’ombre de la vigne se posa instantanément sur le visage de l’homme, le tatouant de noir et de gris. Les feuilles donnaient des triangles, les branches des lignes mystérieuses. Et quelques détails végétaux, paraient son front de petits points inégaux.
Une vraie peinture aborigène, sans les couleurs. Sur sa peau de chef indien.
Véritable cartographie de leurs rêveries à tous. Le dessin de leurs songes.
12:58 | Lien permanent | Commentaires (0)
07 septembre 2010
grève d'en bas.
il n 'y a pas assez de fenêtres.
trop nombreuses les têtes. pour passer dedans.
qui cherche un courant d'air, qui voudrait respirer, avoir des droits encore dans quarante ans.
j'ai oublié toi
qui a couru beaucoup plus vite que les autres
beaucoup plus longtemps je veux dire
tu voudrais aussi respirer j'imagine ?
forcément.
ils ont oublié pour toi
peux pas leur dire, les connais pas
ils feraient semblant d'y réfléchir
c'est encore plus rageant
18:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
06 septembre 2010
eux mêmes.
Chaleur piquante de midi. Une rue suffit à traverser la ville. Une rue qui ne finit jamais, ni de tourner ni de monter. Tout est brulant :es poignées de porte, le capots des voitures, la peaux des filles assises en bas des marches, qui fument.
Tout est lourd à transporter. Les bouteilles de celui-ci, les provisions de celui-là… Les mouches se draguent au dessus des étales de fruits. Les gens sont autre part, à l’ombre, au frais dans les baraques. Tout est lent et les ventilateurs font danser les cheveux dans les petites épiceries.
Deux, trois voitures passent de temps en temps, troublant la tranquillité écrasante de la fin de matinée. Elles s’arrêtent pour les piétons.
Le passage clouté est très blanc et réfléchit la lumière comme un flash. Trois hommes pas misérables, ni appauvris, des hommes simples, traversent la rue. Le regard se fixe sur l’un d’entre eux en particulier. Sa veste lui élargit les épaules alors que son cou est si fin, son visage brun et émacié. Son costume et la coiffure, faute de traduire la richesse espérée, racontent comment la dignité se répartit également de chaque côté de la raie /finement tracée / sur les cheveux qu’il a mouillés un peu, tout à l’heure / devant la glace juste au dessus du lavabo / et qu’il voudrait voir tenir jusqu’à la fin du jour.
Dans la petite pochette à droite, pas de foulard bordeaux en soie, mais un peigne justement et un mouchoir en tissu.
Les voitures attendent patiemment, les vieillards ont bientôt traversé la rue, rejoint l’autre trottoir. Les deux autres parlent assez haut assez fort, et lui, notre homme, dans un même geste automatique, sort peigne et mouchoir de la pochette, redessine la raie dans les cheveux, éponge son nez et ses joues qui avaient transpiré.
puis jette un œil dans une vitrine qui faisait miroir… l’élégance même.
17:25 | Lien permanent | Commentaires (8)
05 septembre 2010
en échange.
Quatre et quatre sièges à l’écart du wagon. Ressembleraient presque à d’anciens compartiments.
Sur les appuis-têtes, leurs cheveux coupés ras laissent parfaitement voir la forme de leur crâne. Ils ont vingt ans, un tout petit peu plus. Ils vont rejoindre leurs régiments.
Y’a plus de guerre, ils disent, avec la bouche qui tirent vers le bas. De toutes façons y’a plus de guerre, alors nous on s’entraîne à autre chose.
Ils ont des chemises et des polos très repassés. Ils ont des plans de vies, pas une seule ride, des dents de fumeurs, des certitudes.
Ils n’ont que des certitudes. Des lignes droites. Y’a des types qui sont là pour leur donner des ordres, eux pour les exécuter et de toutes façons, ce sont des premières classes, les premières classes, sont bons qu’à prendre des coups de pieds au cul, paraît-il.
A voir leurs yeux pourtant, je me dis qu’il faudrait par grand choses pour que leurs lignes, se déraidissent, prennent des virages, se dé-résignent. A voir leur sourire quand ils parlent des ronfleurs de dortoirs, des marches de nuit sans objectif, des déserteurs et des maniaques,
je me dis qu’il y reste une bien grande dose d’enfance, et qu’on verra plus tard.
Ils disent ça aussi, on verra plus tard.
Ils allongent leurs pieds sur les tables très roses et propres du TGV de l’Ouest, à l’ancienne, et se refilent des tuyaux pour ne pas avoir froid quand ils partent en campement. Leurs épaules sont trop vite musclées et leurs visages rendus carrés par les cernes.
En les regardant descendre du train et agiter le bras pour dire au revoir, je me suis demandé, ces gars là, de Loudéac, du Mans, d’Orléans… ils font l’armée à la place de quoi ?
19:14 | Lien permanent | Commentaires (0)